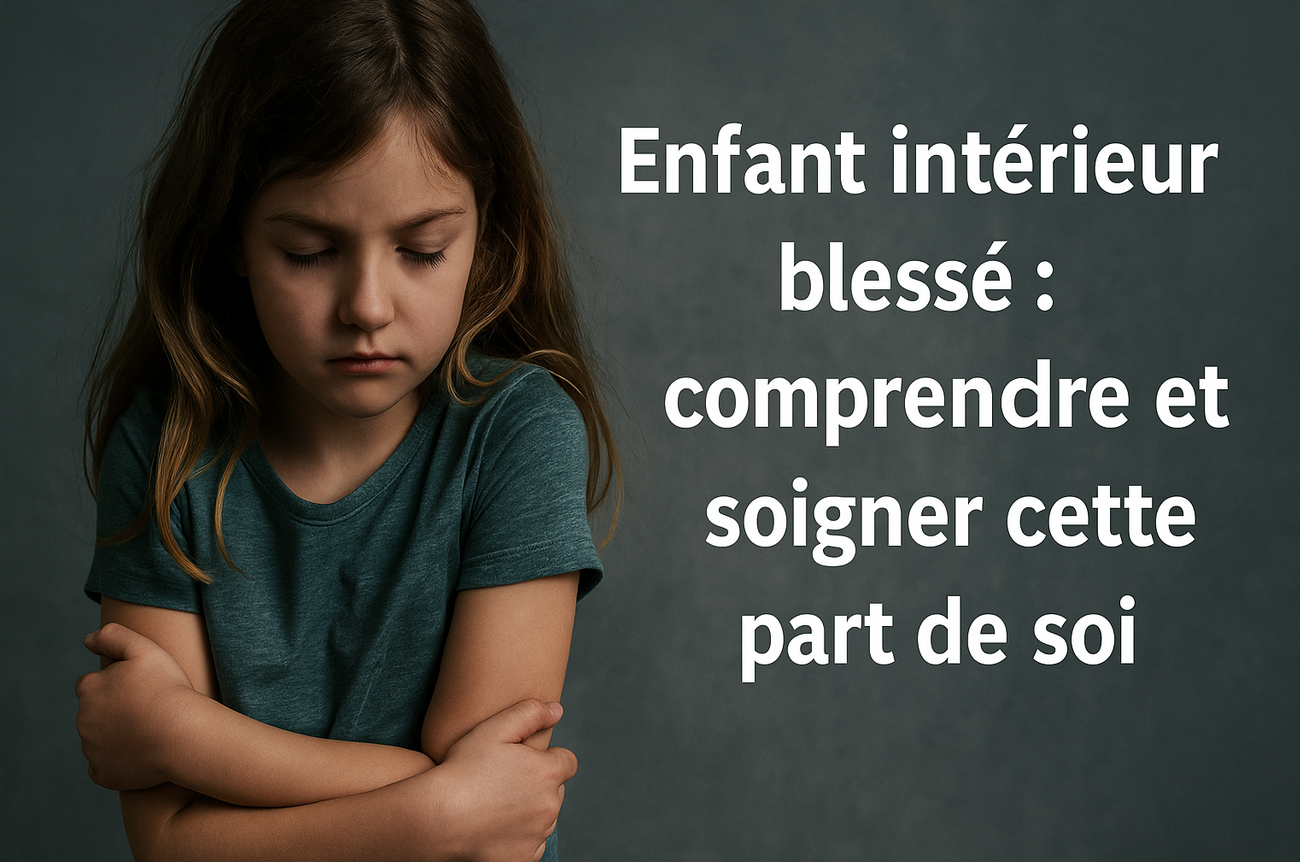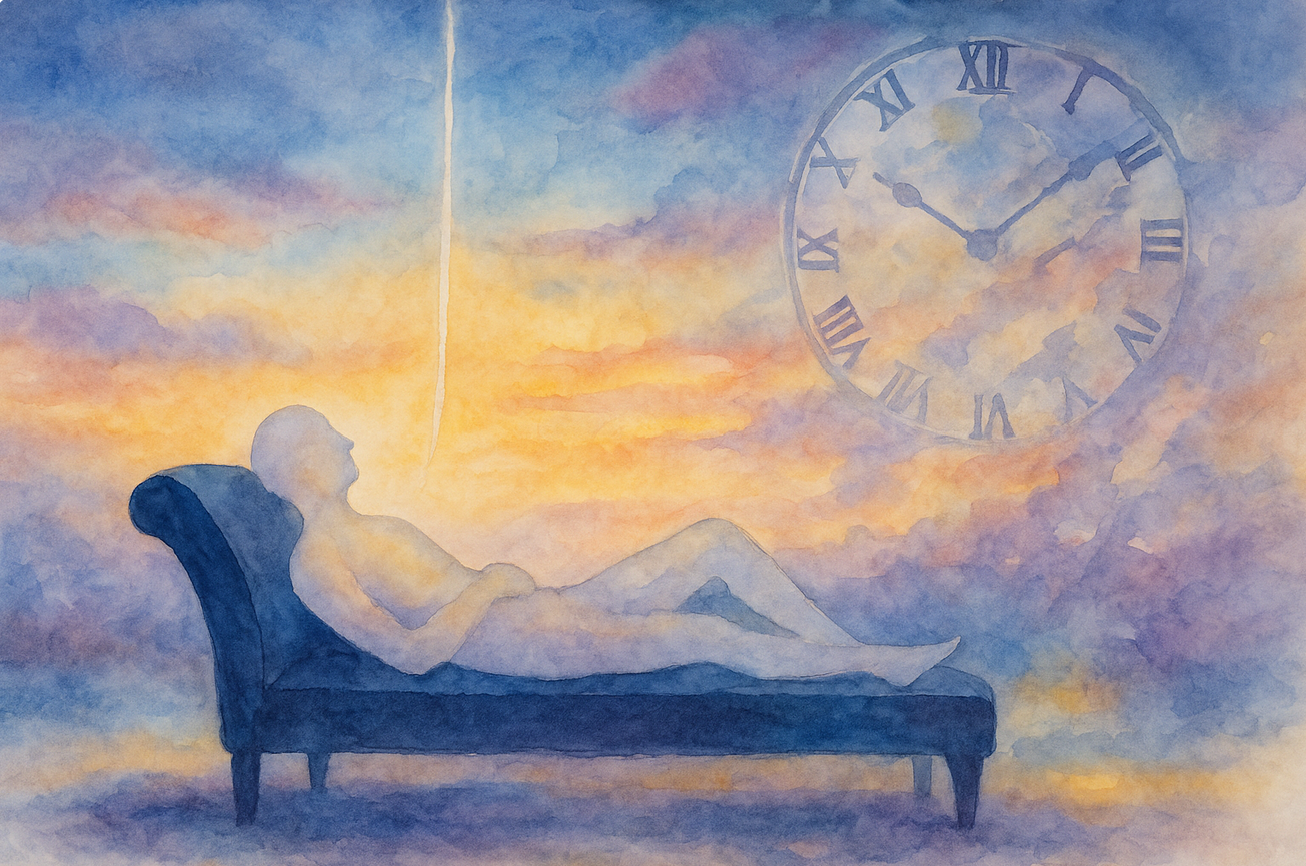
Psychanalyse : Je viens de découvrir que je suis mortel·le
Découvrir qu’on est mortel·le n’a rien d’une évidence : c’est une secousse existentielle qui traverse le corps et le langage. En psychanalyse, cette confrontation avec la finitude n’est pas un drame, mais une naissance symbolique. Le Réel surgit, la fiction d’immortalité s’effondre, et le désir peut enfin s’inscrire dans la vie. Plutôt que d’apaiser l’angoisse, la psychanalyse nous aide à en faire quelque chose : vivre lucidement, aimer avec conscience, créer malgré — et grâce à — la limite. Allez, c’est parti…
Prendre rendez-vous en ligne pour une première séance de psychanalyse à Versailles
« Ce matin, j’ai compris que je vais mourir. Pas demain, pas dans un rêve : moi. »
Lorsque je l’ai reçue, elle avait le visage de ceux qui viennent d’entrevoir quelque chose qu’ils auraient préféré ignorer. Pas de drame, pas de sanglots. Juste ce calme sidéré des moments où la conscience déraille. La veille, un banal résultat d’examen, une phrase du médecin : « tout va bien, mais à votre âge, il faut surveiller ». Rien de grave — et pourtant, tout s’effondrait. Elle ne s’inquiétait pas d’être malade, mais d’être mortelle.
« J’ai toujours su que j’allais mourir, bien sûr, mais là, je l’ai senti. C’est différent. »
Dans ce moment suspendu, quelque chose d’inédit venait de s’ouvrir : la rencontre avec le Réel. Celui que ni la religion, ni la philosophie, ni le yoga ne parviennent à recouvrir.
On ne « découvre » pas la mort, on l'éprouve. Et c’est une toute autre histoire. Tant qu’elle reste une abstraction, la mort nous rassure : elle est loin, diffuse, presque conceptuelle. Mais un jour, sans prévenir, elle se rapproche. Elle s’invite dans un battement de cœur irrégulier, une ride nouvelle, le silence après un enterrement.
Et là, le corps comprend ce que la tête savait depuis toujours.
C’est à ce moment précis que la psychanalyse devient précieuse : non pour consoler, mais pour accueillir la sidération de cette révélation. Car découvrir qu’on est mortel·le, ce n’est pas un drame, c’est une naissance inversée. On sort du ventre chaud des illusions, on perd la sécurité imaginaire du « pour toujours », et l’on tombe — enfin — dans la vie.
Cette chute n’est pas une chute dans le vide, mais dans le Réel : celui que Lacan décrivait comme ce qui échappe au symbolique, ce qui ne peut être dit ni pensé. La mort, c’est cela : le point aveugle du langage, le trou dans le tissu du sens. Et pourtant, c’est dans ce trou que le désir, lui, prend racine.
Lire aussi La souffrance est-elle vraiment inhérente à la vie ?
Quelques chiffres pour penser la mortalité
- 62 % des Français déclarent avoir déjà eu une peur soudaine de la mort, mais seuls 28 % en ont parlé avec un proche (IFOP, 2023).
- 1 Français sur 2 dit avoir changé durablement sa vision de la vie après un deuil ou une maladie grave.
- 70 % des personnes ayant suivi une psychothérapie psychanalytique affirment que la confrontation à la finitude a renforcé leur désir de vivre (Enquête FFP, 2022).
- Environ 15 % des patients en thérapie analytique évoquent spontanément l’angoisse de mort dans les six premiers mois de leur accompagnement.
Pourquoi cette révélation n’est pas anodine
Découvrir qu’on est mortel·le n’a rien d’un simple malaise métaphysique.
C’est une secousse ontologique, une fracture dans la continuité du moi. Jusqu’à ce moment, la plupart de nos gestes, de nos choix, de nos peurs même, reposent sur une fiction : celle d’avoir le temps.
La mort, on le sait, mais on n’y croit pas. Freud parlait de ce clivage psychique : une partie de nous sait la vérité, l’autre la dénie pour survivre. L’inconscient, lui, ne connaît pas la mort. Il se pense immortel, intemporel, comme un enfant persuadé que la nuit disparaît dès qu’il ferme les yeux.
Ce clivage n’est pas pathologique — il est structurel. Il protège le narcissisme, ce noyau intime qui fonde notre sentiment d’existence. L’idée de finitude est une menace directe pour ce narcissisme premier, celui du « je suis ».
Et quand il s’effrite, tout vacille : nos certitudes, nos désirs, nos ambitions, nos amours. C’est pourquoi cette révélation, souvent anodine en apparence, agit comme un séisme silencieux. Elle fait s’écrouler la fantasmatisation d’une toute-puissance : celle de pouvoir réparer, recommencer, contrôler. Elle signe la fin de l’illusion du « toujours ».
Lacan dirait qu’à cet instant, le sujet touche à la castration symbolique : non pas la perte d’un organe, mais celle d’une illusion. L’impossible entre enfin dans le champ du possible.
Et cette impossibilité — celle de ne pas être éternel·le — devient paradoxalement le moteur du désir.
Car c’est précisément parce que nous allons mourir que nous désirons, que nous créons, que nous aimons.
La mort, en psychanalyse, n’est pas l’ennemie de la vie. Elle en est la condition de possibilité.
Lire aussi Qu’est-ce que la projection ?
La mort comme événement du Réel
Il y a des vérités qu’aucun mot ne peut contenir. La mort en fait partie.
On peut la décrire, la penser, la ritualiser — mais au moment où elle s’approche, tout langage se défait. Le symbolique lâche.
C’est cela, le Réel au sens lacanien : ce qui ne se laisse ni représenter, ni apprivoiser, ni contourner. Ce qui échappe, radicalement.
La mort est l’archétype de ce Réel.
Elle ne peut être intégrée qu’à travers des formations de compromis : les rêves, les mythes, la religion, la science, l’humour, ou même la psychanalyse elle-même. Nous en parlons pour tenir à distance l’indicible.
Mais parfois, une faille s’ouvre — une odeur d’hôpital, un faire-part, une douleur soudaine — et le réel surgit, brutalement nu. Plus rien à dire.
Freud le notait déjà : pour l’inconscient, la mort n’existe pas. C’est une invention du langage, un signifiant vide pour désigner ce que nous ne pouvons concevoir. On ne peut pas « imaginer » sa propre mort sans se remettre en scène vivant pour la regarder. C’est une impossibilité logique.
Et pourtant, elle est là, tapie à la lisière de nos pensées, comme le point aveugle de la vision. Pour Lacan, ce point n’est pas un accident : c’est la structure même du sujet. Le sujet se constitue autour d’un manque, d’une béance — et la mort vient la révéler. Elle n’ajoute rien, elle révèle ce qui était déjà là : le trou au cœur du langage, la faille d’où jaillit le désir.
C’est pourquoi cette confrontation n’est pas seulement tragique : elle est fondatrice.
Ce qui, au départ, apparaît comme une angoisse insupportable, peut devenir un pivot d’existence. L’expérience du Réel, si elle est traversée sans se figer dans le désespoir, ouvre sur une autre temporalité du sujet : celle où l’on cesse de vouloir tout maîtriser pour commencer à exister.
Lire aussi Projet de vie ou scénario hérité ?
Comment notre inconscient négocie avec la finitude ?
La mort, on ne la pense pas : on la négocie.
Pas dans les mots, mais dans les rêves, les lapsus, les fantasmes, les œuvres d’art, les excès, les oublis. L’inconscient, incapable de concevoir sa propre disparition, invente mille détours pour l’amadouer.
Le déni d’abord : ce mécanisme élégant par lequel le moi sait et ne sait pas à la fois. Il permet de continuer à vivre comme si rien n’était arrivé, tout en pressentant qu’un jour, « quelque chose » arrivera. Le déni n’est pas faiblesse : c’est un dispositif de survie psychique. Vient ensuite la sublimation : transformer l’angoisse de mort en élan créatif, en amour, en soin, en œuvre. Chaque artiste, chaque parent, chaque thérapeute fabrique, quelque part, une réponse à sa propre finitude. Créer, c’est refuser la disparition.
Mais c’est aussi, parfois, une façon d’apprivoiser la perte — d’en faire quelque chose de transmissible.
Certains plongent dans l’obsession : compter, vérifier, contrôler, comme pour suspendre le temps. D’autres s’abandonnent à la frénésie, cette fuite en avant de la jouissance où l’on tente d’échapper à la pensée de la mort par la saturation du plaisir.
Mais derrière chaque excès, il y a souvent la même peur nue : celle de disparaître sans trace.
Les rêves de mort, eux, racontent autre chose : non pas la fin, mais la transformation. Mourir y devient un passage, une métaphore du changement psychique. L’inconscient ne met jamais en scène la mort biologique : il figure la mutation du sujet. Chaque rêve où l’on meurt est un rêve de renaissance symbolique.
Et puis il y a la pulsion de mort, cette compagne inséparable d’Eros, décrite par Freud : un mouvement vers le repos, la dissolution, le retour à l’inanimé. Elle n’est pas pure destruction : elle coexiste avec la pulsion de vie dans un équilibre fragile. Ensemble, elles tissent le tissu même du psychisme.
Ainsi, le travail analytique n’abolit pas la mort : il permet de danser avec elle, sans se laisser happer ni par la peur, ni par la toute-puissance.
Apprendre à mourir un peu, à chaque séance, c’est aussi apprendre à vivre.
Lire aussi Trouble de l’adaptation : comment le reconnaître et le surmonter ?
Que révèle cette expérience de la vérité du sujet ?
Découvrir sa propre mort, ce n’est pas découvrir la fin — c’est découvrir le manque.
Celui qui était là depuis toujours, tapi derrière le « je veux », le « je peux », le « je suis ».
Quand la mort se révèle, ce n’est pas la vie qui s’éteint : c’est l’illusion d’un moi complet, plein, inaltérable, qui s’effondre.
C’est là que commence le travail analytique.
La psychanalyse n’a pas pour but de supprimer l’angoisse, mais de la traverser pour en extraire du sens.
L’angoisse de mort n’est pas pathologique : elle est le signe que le sujet a entrevu quelque chose de vrai sur lui-même.
Freud disait que la santé mentale n’est pas l’absence d’angoisse, mais la capacité à lier cette angoisse à une représentation, à un récit. Lacan ira plus loin : le sujet ne se fonde pas sur une identité, mais sur une faille. Cette faille, que la mort vient rappeler, est précisément ce qui rend possible le désir.
Car le désir naît là où quelque chose manque.
Si nous étions immortels, tout-puissants, comblés — il n’y aurait plus rien à désirer, plus rien à créer.
C’est la finitude qui nous pousse à aimer, à écrire, à transmettre, à risquer.
La mort, paradoxalement, est ce qui donne la valeur du vivant.
Découvrir sa mortalité, c’est donc rencontrer ce point de vérité que le moi évite soigneusement : je ne suis pas maître de ma vie, encore moins de ma mort.
Mais je suis responsable de ce que j’en fais, ici, maintenant.
Là réside toute l’éthique du psychanalyste : ne pas détourner le regard de ce réel, ne pas promettre d’immortalité psychique, mais accompagner le sujet dans cette expérience de lucidité radicale, là où la conscience de la mort ne détruit plus, mais éclaire.
C’est souvent à ce moment du parcours analytique qu’un patient dit : « Ce n’est pas que j’ai moins peur de mourir… c’est que je commence enfin à vivre. »
Comment continuer à vivre après avoir découvert qu’on va mourir
On ne revient jamais indemne d’une telle découverte.
Quand la conscience de la mort cesse d’être une idée et devient une expérience, quelque chose change de texture dans la vie. Le monde n’est pas plus doux, mais il devient plus vrai.
Le premier réflexe est souvent la panique : que faire, maintenant que tout est compté ? Faut-il courir, jouir, aimer plus fort ? Mais très vite, une autre réponse s’impose : il n’y a rien à faire, sinon être là. La mort, en dévoilant la limite, nous rend à la présence. Dans le champ psychanalytique, cette traversée ouvre la porte à une temporalité inédite : celle du désir incarné. Désirer non plus pour combler le manque, mais pour célébrer le vivant.
Faire de chaque acte, chaque lien, chaque création, non une fuite du néant, mais une manière de dire : « j’y étais ».
Les philosophies existentielles rejoignent ici la psychanalyse : vivre, c’est consentir à sa finitude.
Heidegger parlait d’« être-pour-la-mort » — non pas une obsession morbide, mais un art de la lucidité.
Savoir qu’on va mourir, c’est comprendre que rien n’est dû, que tout est à aimer pendant qu’il est temps. La psychanalyse n’enseigne pas à ne plus craindre la mort, elle apprend à ne plus s’y soumettre. Elle nous rappelle que la mort ne vient pas seulement à la fin : elle est déjà là, discrète, dans tout ce qui passe — et c’est cela qui rend la vie si précieuse.
On croit souvent qu’accepter la mort, c’est se résigner. C’est l’inverse. Accepter la mort, c’est refuser de laisser la peur gouverner son existence. C’est oser parler, aimer, créer, sans garantie.
Et si le véritable courage n’était pas de vaincre la mort, mais de l’intégrer comme compagne de route ? Elle marche à nos côtés, silencieuse, pour nous rappeler qu’il y a urgence à être vivant.
Boris Vian et le désir de vivre
S’il est un poète qui a su parler de la mort sans en perdre la musique, c’est bien Boris Vian.
Dans Je voudrais pas crever, il ne supplie pas le destin : il énumère tout ce qu’il veut encore goûter, sentir, embrasser, avant de partir.
C’est une prière athée, une déclaration d’amour à la vie dans ce qu’elle a de plus trivial, sensuel et incongru.
« Je voudrais pas crever
Avant d’avoir goûté
La saveur des larmes
Des gens qu’on pleure
Avant d’avoir touché
Le velours du soir
Avant d’avoir su
Ce qu’on peut voir de beau
Quand on ferme les yeux… »
Cette écriture sans pathos, tout en urgence, fait écho à ce que la psychanalyse enseigne :
tant qu’il y a du désir, il y a du vivant.
Même confronté à la finitude, le sujet continue de vouloir, d’aimer, de dire.
Boris Vian ne cherche pas à nier la mort — il la défie par le plaisir, par la curiosité, par la poésie.
Et c’est peut-être cela, la plus belle réponse à l’angoisse existentielle : transformer la peur en appétit, la finitude en intensité.
« Je voudrais pas crever
Sans avoir connu
Les chiens noirs du Mexique
Qui dorment sans rêver
Les singes à cul nu
Dévoreurs de tropiques… »
Chaque vers résonne comme une petite insurrection contre le néant, un refus d’être mort avant de mourir.
En cela, Vian rejoint Freud et Lacan : le désir est invincible, même face au Réel.
Conclusion ?
Découvrir qu’on est mortel·le, c’est peut-être la plus radicale des expériences spirituelles.
Non celle qui promet une autre vie, mais celle qui nous réveille à celle-ci.
La psychanalyse, dans son humilité, ne cherche pas à consoler : elle ouvre un espace où cette vérité peut se dire, se penser, se transformer en désir.
Et si, au fond, la mort n’était pas une fin, mais un témoin — celui qui nous rappelle que chaque instant est unique, irremplaçable, et profondément vivant ?
« Ce n’est pas la mort qu’il faut craindre, mais de ne pas avoir vécu. » — Marc Aurèle
F.A.Q – Mort, angoisse et psychanalyse : les questions que tout le monde se pose...
Pourquoi découvre-t-on sa mortalité si tard dans la vie ?
Parce que le psychisme humain repose sur une illusion vitale : celle d’être éternel.
Ce mécanisme de défense préserve l’équilibre narcissique. La conscience réelle de la mort surgit souvent à la faveur d’un traumatisme, d’un deuil, d’une maladie ou d’une rupture symbolique. C’est une étape psychanalytique naturelle : la chute du fantasme d’immortalité ouvre un espace de vérité où le sujet peut commencer à se reconstruire autrement.
La peur de mourir est-elle pathologique ?
Pas nécessairement.
Elle devient pathologique lorsqu’elle envahit le quotidien ou s’accompagne d’un état anxieux permanent. En psychanalyse, cette peur est comprise comme une angoisse existentielle, structurante si elle est mise en mots. Un travail psychothérapeutique ou psychanalytique permet d’en repérer les racines symboliques et de transformer cette peur en moteur du désir de vivre.
Comment la psychanalyse aborde-t-elle la mort ?
La psychanalyse ne cherche pas à apaiser la peur de la mort, mais à en comprendre la fonction.
Elle considère la mort comme un événement du Réel, impossible à symboliser, qui réveille l’angoisse de castration et la limite du langage. En séance, le psychanalyste accompagne la traversée de cette angoisse pour qu’elle devienne un espace de subjectivation, non un lieu de terreur.
Pourquoi le déni de la mort est-il si universel ?
Parce qu’il protège le psychisme.
Le déni n’est pas un refus de savoir, mais un savoir neutralisé pour continuer à vivre. L’inconscient ignore la mort : il fonctionne selon une logique atemporelle. Ce clivage entre savoir et croyance permet de maintenir la cohérence du moi. La psychanalyse aide à articuler ce double mouvement sans que l’un détruise l’autre.
La conscience de la mort rend-elle plus heureux ?
Étrangement, oui.
Les recherches en psychologie existentielle (Yalom, Becker) montrent qu’une conscience apaisée de la finitude renforce la gratitude et le sens. La mort, intégrée sans effroi, invite à vivre plus intensément, à aimer plus librement, et à renoncer à la perfection. Elle ne retire rien : elle éclaire tout.
Pourquoi la mort est-elle un tabou dans la société moderne ?
Parce qu’elle contredit le culte de la performance, de la jeunesse et de la maîtrise.
Notre époque valorise la réparation et le contrôle, or la mort échappe à tout cela. En psychanalyse, on dirait qu’elle révèle le trou dans le symbolique. Ce refoulement collectif entretient un malaise existentiel : on meurt sans y avoir jamais pensé.
Peut-on vraiment “accepter” la mort ?
Pas totalement.
On ne s’habitue jamais à l’idée de mourir. Mais on peut apprivoiser cette angoisse, la transformer en boussole. La thérapie psychothérapeutique, psychanalytique ou existentielle aide à vivre avec cette limite sans qu’elle paralyse. Accepter la mort, ce n’est pas renoncer à la vie : c’est y entrer pleinement.
Quel lien entre peur de mourir et peur de vivre ?
Elles sont intimement liées.
Beaucoup de patients découvrent, en analyse, que la peur de mourir masque la peur d’exister vraiment : d’aimer, de perdre, de choisir. La mort, en venant rappeler la finitude, confronte le sujet à ce qu’il n’a pas encore vécu. Traverser cette angoisse, c’est rouvrir le champ du désir vivant.
Comment accompagner une personne angoissée par la mort ?
L’écoute empathique est essentielle.
Éviter les banalités du type « tout le monde y passe » ou « il faut penser à autre chose ». La personne a besoin que son angoisse soit entendue, pas niée. Un thérapeute ou psychanalyste peut aider à élaborer cette peur, à la relier à des pertes plus anciennes et à lui redonner une dimension symbolique.
Et si je n’ai plus peur, est-ce grave ?
Pas du tout.
L’absence de peur peut traduire une acceptation profonde, ou un mécanisme de déni : seule une exploration intime peut le dire. Ce qui compte, c’est le rapport vivant à la mort, pas son intensité émotionnelle. La psychanalyse vise la lucidité, pas la suppression du sentiment. On peut vivre pleinement sans être hanté·e.
Les troubles anxieux liés à la mort relèvent-ils d’un suivi psychiatrique ?
Certains cas nécessitent un suivi psychiatrique lorsque l’angoisse devient invalidante.
Un travail conjoint entre psychologue, psychanalyste et psychiatre peut être indiqué. L’approche psychothérapeutique permet d’identifier les déclencheurs, tandis que la dimension psychanalytique explore le sens profond de cette peur dans l’histoire du sujet.
Quelles formes de thérapie existent pour les personnes anxieuses face à la mort ?
Outre la psychanalyse, des approches cognitives et comportementales, humanistes ou systémiques peuvent aider.
Le choix du type de thérapie dépend du profil et du vécu. L’essentiel est de trouver un cabinet de psychologie où l’on se sent en confiance, capable d’aborder la mort sans détour ni jugement.
La peur de la mort peut-elle provoquer des troubles du comportement ?
Oui, parfois.
Certaines personnes développent des conduites compulsives ou des addictions pour étouffer leur angoisse. L’hyperactivité, la frénésie de contrôle ou les achats impulsifs peuvent masquer une souffrance psychique liée à la finitude. Une approche psychothérapeutique ou relationnelle aide à décrypter ces comportements.
Pourquoi certains deviennent-ils obsédés par la mort ?
L’obsession de la mort peut traduire un trouble anxieux pathologique ou un conflit inconscient non élaboré.
La thérapie analytique explore les liens entre cette peur et des traumatismes anciens, souvent liés à la perte ou à l’abandon. Ce travail psychique transforme l’angoisse morbide en compréhension symbolique.
Faire une psychothérapie aide-t-il à apaiser la peur de mourir ?
Oui, une psychothérapie bien menée agit comme un espace de parole et de symbolisation.
Le thérapeute aide à reconnaître les émotions et les fantasmes autour de la mort, sans chercher à les effacer. Cette approche psychothérapeutique développe l’empathie envers soi-même et permet de renouer avec un désir de vie plus apaisé.
La peur de la mort peut-elle révéler une névrose ou une psychose ?
Oui.
Chez certains sujets, l’angoisse de mort devient un symptôme névrotique, lié à des conflits inconscients entre le moi, le ça et le surmoi. D’autres basculent dans un registre plus psychotique, où la mort est vécue comme une intrusion du Réel. L’analyste ou le psychothérapeute clinicien aide alors à distinguer ces structures et à restaurer une cohérence de la psyché, soutenue par une approche psychodynamique et parfois systémique.
Comment les mécanismes de défense agissent-ils face à la mort ?
Les mécanismes de défense décrits dans la théorie freudienne — refoulement, projection, déni — protègent la psyché de l’angoisse traumatique.
Mais lorsqu’ils deviennent rigides, ils empêchent la guérison. L’approche psychodynamique ou comportementale permet de rendre ces processus plus conscients, d’en identifier la fonction corporelle (tension, inhibition) et d’aider le sujet à guérir sans effacer le sens symbolique de sa peur.
Quel rôle jouent Jung et Freud dans la compréhension de la mort ?
Pour Freud, la mort révèle la lutte entre pulsions de vie et pulsions de mort, inscrites dans la psychopathologie du sujet.
Pour Jung, elle ouvre un processus d’individuation, une transformation inconsciente de la psyché vers plus d’unité. L’un comme l’autre y voient un passage, non une fin. Le praticien humaniste ou psycho-analyste freudien peut accompagner ce cheminement affectif et symbolique, qu’il s’agisse d’un conflit obsessionnel, névrotique ou psychotique, jusque sur le divan ou dans une thérapie comportementale adaptée aux troubles mentaux comme la schizophrénie.
.webp)