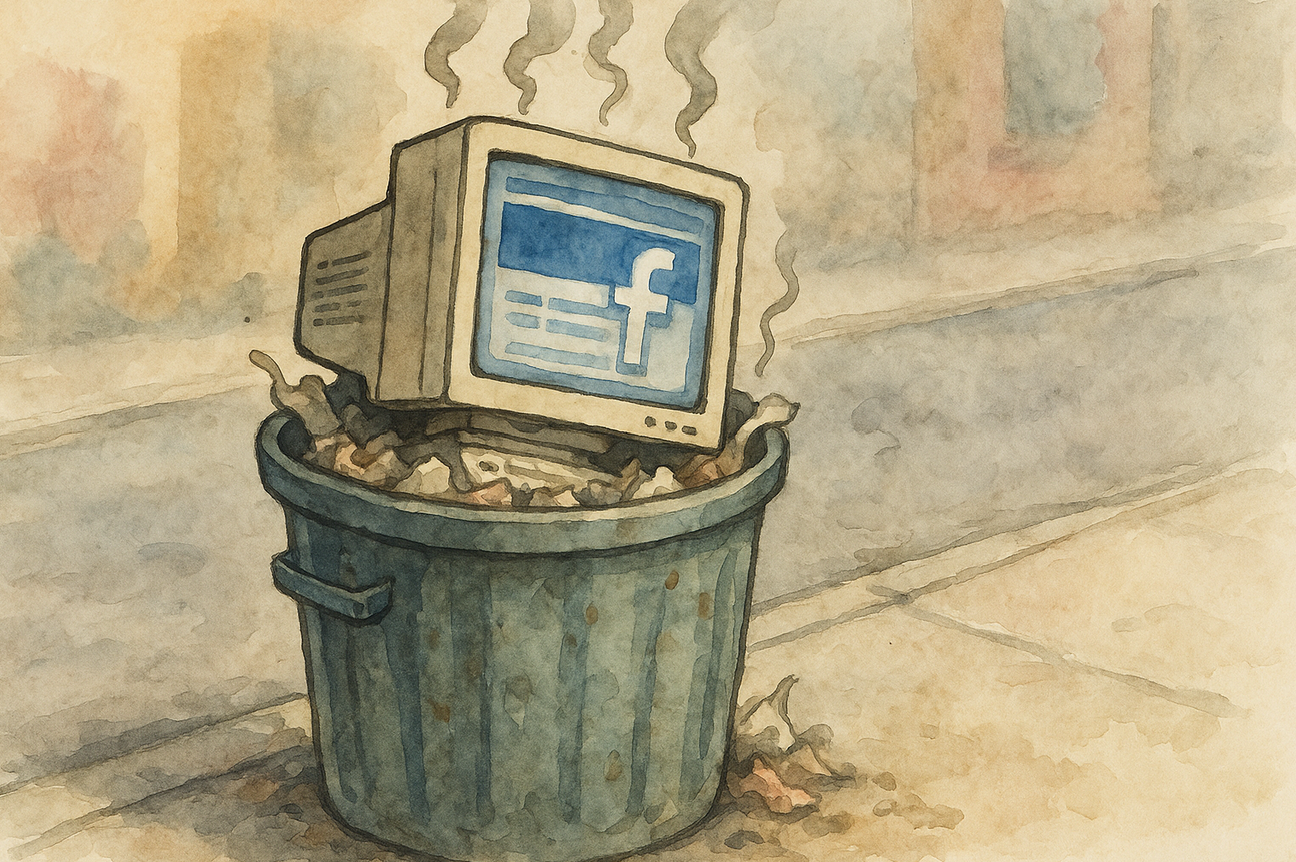
Comment survivre au tout-pourri...
Il fut un temps où transgresser avait du panache. Où l’interdit existait, et avec lui — tenez-vous — le désir. Aujourd’hui ? Tout est permis, tout est visible, tout est énonçable, tweetable, scrollable. Et pourtant… jamais l'humain n’a semblé aussi éteint, aussi dissous, aussi exsangue de désir. On ne vit plus, on commente. On ne pense plus, on “réagit”. On ne désire plus, on “consomme”. Bienvenue dans le règne du tout-pourri — cet air du temps où plus rien ne tient, parce que tout se vaut. Où l’autorité n’est plus contestée : elle est caricaturée, liquéfiée, remplacée par l’algorithme et l’opinion chaude. Ce n’est pas l’effondrement du Symbolique. C’est pire : c’est son remplacement par un brouhaha satisfait. Et vous voudriez guérir de quoi, au juste ? D’un monde qui vous flatte à mort tout en vous laissant mourir intérieurement ? Ou de cette jouissance fade, gluante, qui colle aux doigts comme un bonbon périmé ? Bah oui, aujourd'hui, je suis fâchée...
Pour ceux qui souhaitent aller au-delà du bruit numérique et retrouver un espace intérieur vivant, la psychanalyse à Versailles peut être un chemin précieux
Lorsque j’ai reçu Léna, 27 ans, elle s’est assise sans vraiment me regarder, le regard fixé sur un point flottant, quelque part entre la vitre et le vide, et elle a prononcé d’une voix plate, presque lasse, cette phrase qui résume, à elle seule, notre époque :
« J’ai décidé de ne faire confiance à personne. Pas aux psys, pas aux médecins, pas aux institutions, pas aux hommes, pas aux femmes, pas aux amis… On finit toujours trahi. Alors autant s’épargner l’effort. »
Puis, comme pour se rattraper de son propre cynisme, elle a ajouté, dans un souffle presque coupable :
« Mais je vous écoute quand même, hein. Peut-être que vous ferez mentir les statistiques. »
Dans ce mélange d’ironie, d'épuisement, de défiance exaltée et de fragile espoir, j’ai entendu ce que Lacan nommait le tout-pourri : cette posture fondamentale où le sujet préfère annuler tout idéal plutôt que d’en risquer la chute.
Nous y sommes. Et nous y vivons tous, chaque jour, un peu plus.
Qu'appelle-t-on le tout-pourri chez Lacan ?
Le tout-pourri, dans le lexique lacanien, n’est pas un simple jugement moral, ni une posture philosophique désabusée, mais la conséquence d’un basculement anthropologique : l'effondrement du signifiant-maître et, avec lui, la défaillance des instances symboliques qui organisent le désir.
C’est une structure psychique dans laquelle :
- l’Autre est supposé trompeur ;
- le savoir est réputé imposteur ;
- la loi est perçue comme une mascarade ;
- tout discours d’autorité est reçu comme manipulation ;
- et la seule valeur stable devient… la suspicion.
« Puisque tout est déjà corrompu, je n’ai rien à perdre en méprisant ce monde. »
Le sujet tout-pourri ne critique pas : il annule.
Il ne dénonce pas pour réparer : il dénonce pour ne rien avoir à vouloir.
Ce n’est pas un scepticisme éclairé. C’est une défense contre le désir, contre le manque, et donc contre la possibilité même d’être engagé dans le monde.
Pourquoi ce concept éclaire notre époque ?
Parce que nous vivons dans un moment historique où le soupçon a remplacé la croyance, où la défiance a supplanté la pensée, où l’ironie vaut preuve, où le sarcasme devient compétence sociale et où la critique — si elle n’est plus articulée — se vit comme un droit inaliénable à s’indigner sans jamais risquer d’être impliqué.
Le tout-pourri s’épanouit là où la fonction du Père — au sens symbolique, non biographique — n’est plus opérante.
On ne conteste plus la Loi : on nie qu’elle ait jamais pu exister.
On ne désobéit plus : on invalide le principe même d'obéissance.
On ne cherche plus la vérité : on soupçonne tout discours de mensonge.
Dans ce geste, il y a une victoire apparente — celle de l’ego désillusionné — mais aussi un prix immense : la disparition de toute possibilité d’altérité fiable.
Lorsque l’Autre est toujours suspect, l'intime devient dangereux et la liberté se mue en isolement.
La société du soupçon permanent : quelques chiffres
Selon une enquête Ipsos de 2024, 67% des Français déclarent ne faire confiance à aucune autorité politique.
Selon l’IFOP, 52% doutent désormais des données scientifiques officielles.
Et un sondage Harris montre que 60% des 18-30 ans se disent "désabusés du monde social".
Nous n’assistons donc pas à une crise d’opinion, mais à une crise de l'Autre, c’est-à-dire à une crise du Symbolique, au sens lacanien du terme.
Ce n’est plus seulement que les institutions déçoivent — elles n’ont plus la structure nécessaire pour être crues.
Le Père ne chute pas parce qu’il échoue : il chute parce qu’on ne veut plus de Père.
Lire aussi Pourquoi explorer "Les noms-du-père" est-il intéressant pour comprendre la psyché ?
Le tout-pourri dans la vie sociale et politique
Nous vivons dans un théâtre permanent où le dévoilement vaut action, où « exposer » remplace « comprendre », et où l’indignation sert d’étendard identitaire.
Ouvrez n’importe quel fil Twitter, pardon... X.
On ne discute pas de politique, on démasque.
On ne formule pas d’idées, on annule.
On ne propose rien, on détruit.
Cela ne relève pas de la contestation politique démocratique, mais d’une jouissance du soupçon.
Le tout-pourri ne cherche pas la vérité : il veut prouver qu'il a eu raison de ne jamais y croire.
L’affaire "Brigitte Macron serait transgenre" : une illustration emblématique
Évacuons ce point immédiatement :
Ce fantasme conspirationniste n’a rien à voir avec la transidentité ni avec la question de genre.
Il relève d'une tout autre logique : la volonté de souiller l’Autre symbolique.
Pourquoi cette rumeur cristallise-t-elle autant ?
Parce qu’elle attaque, en un seul geste :
- la fonction maternelle symbolique
- la dignité du féminin
- la position présidentielle
- l’institution conjugale
- la notion de secret intime légitime
- l’idée même d’autorité
Il ne s’agit pas de savoir, mais de délégitimer le lieu du pouvoir.
Comme le dit Lacan :
« Là où manque le Nom-du-Père, surgit la certitude délirante. »
Le tout-pourri ne veut pas savoir qui est Brigitte Macron : il veut pouvoir dire qu’aucune figure symbolique n'est digne.
C’est le fantasme démocratique retourné : non pas tous égaux, mais personne ne vaut plus rien.
Dans l’intime : anatomie d’une génération méfiante
Revenons à Léna. Ou plutôt à cette génération qui dit : « Je ne veux pas dépendre de quelqu’un, je veux être libre. »
Puis, dans le même souffle : « Mais je veux un amour vrai, stable, fidèle, passionné, safe et parfaitement clair émotionnellement. »
Le tout-pourri intime consiste à désirer l’amour sans jamais lui faire crédit, à vouloir le lien sans le risque, à refuser la dépendance tout en exigeant la sécurité absolue, et à confondre maturité émotionnelle et absence de faille humaine.
Nous demandons à l'autre d'être parfait pour nous éviter d'être déçus.
Et, lorsqu’il échoue — parce qu’il échouera nécessairement — nous déclarons que l’amour est mort, pourri, impossible.
Nous n'avons pas renoncé à l’idéal : nous avons renoncé à la possibilité de sa perte.
Culture numérique et épidémie de certitudes toxiques
Il suffira de 30 secondes de TikTok psy pour que la réalité du sujet se dissolve dans un lexique pseudo-clinique
Un visage parfaitement éclairé, un ton assuré, des mots coupants débités comme des verdicts, et cette étrange impression qu’une génération entière tente de se soigner en s’auto-assignant des diagnostics importés du DSM par voie express algorithmique. On ne tâtonne plus, on ne cherche plus, on déclare. On n'écoute pas l'expérience intérieure, on plaqu(e) le vocabulaire thérapeutico-marketing du moment comme si nommer équivalait à comprendre.
Un garçon ne répond pas assez vite ?
« C’est de l’évitement émotionnel, protège-toi. »
Une amie prend un peu de distance parce qu’elle traverse une période difficile ?
« Mauvaise énergie, coupe le lien avant d’être contaminé.e. »
Un partenaire exprime un malaise, incertain, maladroit, humain ?
« Manipulation subtile, red flag immédiat. »
Une émotion arrive, brute, débordante, sans mode d’emploi ?
« Trauma. Forcément. »
Et si l’angoisse d’être abandonné surgit — ce fond archaïque que nous portons tous — elle devient aussitôt un signal d’urgence, non plus pour explorer sa source, mais pour fuir l’Autre avant qu’il ne puisse décevoir.
Dans cet univers, la pensée n’a plus le droit d’hésiter. Le doute n’est plus une étape de maturation psychique mais un signe de faiblesse, et l’incertitude — cet espace pourtant indispensable où peut naître le désir et se construire une relation — est vécue comme une menace qui doit être éradiquée immédiatement. Ainsi, chaque relation devient un terrain miné où le soupçon précède la rencontre, où le catalogue des signaux d’alerte remplace le regard, et où l'autre est moins une présence qu’une potentielle catastrophe psychique en préparation.
On ne cherche plus à comprendre l’autre, ni à se laisser toucher par lui ; on cherche à ne pas être dupé, blessé, affecté, transformé. À force de surveillance, plus personne n’entre ; à force de défenses, il ne reste rien à défendre.
Quand le diagnostic devient arme, l’inconscient s’efface au profit du radar à danger.
Quand la vulnérabilité ne sert plus de point de départ, elle devient un signe de faiblesse à éliminer.
Et dans cette logique, l’autre cesse d’être sujet, avec sa complexité, ses zones floues, son histoire singulière.
Il devient hypothèse menaçante, risque à neutraliser, avatar psychique potentiel d’un danger déjà pré-catégorisé par des millions de “conseils” de 15 secondes.
Le résultat ? Une génération bardée d’informations psychologiques, mais pauvre en expérience relationnelle symbolique.
Hyper-équipée pour identifier des traumas, mais désarmée pour tolérer la rencontre.
Experte en auto-protection, mais novice en confiance — cette confiance qui n’est jamais donnée, seulement choisie, risquée, éprouvée.
Nous n’avons jamais autant parlé de relations saines, et pourtant, paradoxalement, nous n'avons jamais eu aussi peur de l’autre.
Lire aussi Le phallus : Ce drôle de signifiant qui fait courir tout le monde
Derrière le cynisme : une douleur
Il est tentant de se moquer de cette génération qui ironise sur tout, qui tourne tout en dérision, qui ne s’attache qu’avec clauses de sortie, qui aime en mettant l’airbag émotionnel en position “ON permanent”. Facile de les appeler désabusés, dramatiques, perchés, ingrats, trop gâtés. Pourtant, ce serait manquer la vérité de leur symptôme. Le cynisme n’est pas un triomphe de la lucidité ; c’est un mécanisme de survie, et parfois le dernier mur avant l’effondrement.
Derrière le tout-pourri ne se cache pas une intelligence supérieure qui aurait percé le grand secret de la condition humaine. Ce qui s’y loge, c’est une blessure archaïque — celle de l’enfant qui a trop vite compris que l’amour n’est jamais garanti, que la présence peut s’effriter, que la promesse n’est qu’un souffle, que la relation la plus précieuse peut se fissurer sans prévenir. Alors il a grandi avec une certitude : mieux vaut ne rien attendre que risquer de perdre.
C’est la souffrance silencieuse de celui ou celle qui, intérieurement, murmure :
« Si je n’espère pas, je ne souffrirai pas.
Si je n’aime pas trop, je ne serai pas abandonné(e).
Si je n’ouvre pas la porte, on ne pourra pas me la claquer. »
Mais la psychanalyse, patiemment, doucement, parfois cruellement vraie, nous le rappelle :
se protéger du manque, c’est se priver du désir.
Et se priver du désir, c’est accepter de vivre à moitié ; c’est consentir à une forme de mort douce, anesthésiée, socialement valorisée parce qu’elle “protège”, mais profondément infertile. On ne souffre peut-être plus — mais on ne goûte plus rien non plus.
Ne nous y trompons pas : le cynique n’est pas fort.
Il n’a pas gagné contre le monde.
Il est terrifié. Terrifié par la dépendance, par la perte, par l’incertitude constitutive du lien humain, et surtout par cette vérité fondamentale : aimer nous met à nu.
Aimer nous rend mortels.
Et voilà le paradoxe tragique de notre époque :
pour ne plus jamais tomber, certains renoncent à marcher.
Pour ne plus souffrir, ils renoncent à vivre.
C’est cela, le tout-pourri : un rempart contre la douleur qui devient prison du désir.
Lire aussi Explorer l'inconscient : L'acte psychanalytique selon Jacques Lacan
5 pistes pour sortir du tout-pourri
1. Réintroduire le manque
Le manque n’est pas une défaillance, ni un vide honteux à combler au plus vite. Il est moteur du désir, appel, respiration de l’âme, pli où se loge l’humanité.
Lorsque nous rêvons d’un monde parfait, lisse, nettoyé de toute friction, nous fabriquons un univers aseptisé mais inhabitable, où plus rien n’a de goût.
Accepter l’imperfection — la sienne, celle de l’autre, celle du monde — c’est se rendre à nouveau capable d’aimer, et de se laisser toucher.
2. Rendre sa place au symbolique
Il ne s’agit pas de ressusciter des dogmes poussiéreux ni de chercher un Maître auquel obéir. Il s’agit de reconnaître que sans parole fiable, sans transmission, sans limite ni engagement, aucune subjectivité ne se construit. On ne se libère pas en détruisant toutes les autorités, mais en choisissant celles qui nous permettent de nous appuyer pour penser et désirer. Là où tout se vaut, rien ne vaut. Là où plus rien n’est reconnu, plus rien ne peut être reçu.
3. Revenir à la nuance
Notre époque adore les verdicts instantanés, les postures définitives, les sentences prêtes à commenter et annuler.
Pourtant, penser exige du temps, de la contradiction, des hésitations, parfois un silence. Cela demande la lenteur d’une conversation réelle, où l’autre n’est pas un adversaire mais un partenaire de sens.
La nuance n’est pas faiblesse ; elle est le courage d'habiter le réel, sans armure idéologique ni certitudes low-cost.
4. Considérer que l’Autre n’est pas nécessairement ennemi
Redonner à autrui le bénéfice du doute, oser la confiance graduée, c’est accepter d'être en relation plutôt que simplement en vigilance.
La méfiance radicale n’est pas lucidité — c’est claustration psychique, forteresse dont on possède la clé mais que l’on n’ose pas quitter de peur du vent.
La vie ne commence pas lorsqu’on élimine le risque d’être blessé ;
elle commence lorsque l’on comprend que la blessure possible fait partie de la rencontre.
5. Se risquer au désir
Aimer, espérer, s’engager, croire — non par naïveté, mais comme un acte adulte, un consentement au vivant.
Le risque n’est pas une menace à éviter ; c’est le prix de toute subjectivation, le sceau du réel. Le cynisme ne protège pas : il momifie, il dessèche, il prive le cœur de son propre battement.
Comme le disait Lacan : « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. »
Et pourtant — c’est encore là, dans ce saut irrationnel, ce don fragile, ce pari fou, que se produit le miracle humain.
Non pas la perfection, mais la vie qui palpite malgré tout.
Lire aussi Clinique lacanienne : L’instance de la lettre dans l’inconscient
Faut-il mettre les réseaux sociaux à la poubelle ? Oui, ou au moins les laisser dehors la nuit...
Notre époque se veut lucide, mais elle est effrayée.
Elle se croit forte parce qu’elle méprise, mais elle se défend de tout.
Elle pense être libre parce qu’elle rejette, mais elle s’interdit d'espérer.
Le tout-pourri n’est pas une opinion sur le monde.
C’est une affectation du désir.
Une melancolie contemporaine.
Une défaite intime travestie en clairvoyance.
Alors, faut-il jeter les réseaux sociaux ?
Oui, sans doute.
Ou du moins, les laisser dehors, comme on laisse un enfant un peu trop nerveux, un peu trop imprévisible, retrouver son calme dans sa chambre avant de le réinviter au salon. Parce que nous ne savons plus les habiter — ce sont eux qui nous habitent. Ils colonisent l’attention, modèlent l’émotion, pré-mâchent la pensée, offrent des certitudes en sachets individuels et du sens prêt-à-consommer.
Et le plus tragique, c’est peut-être ceci : nous les consultons non pas pour voir le monde, mais pour être dispensés d'avoir à le sentir.
Lorsque je ferme la porte du cabinet le soir, il m’arrive de penser que la bataille est perdue.
Non pas que le sujet soit définitivement mort — Lacan disait bien que le sujet surgit dans une faille — mais parce que cette faille, aujourd’hui, se comble trop vite.
Par un scroll, un mot-clé, un diagnostic express, un mème pseudo-philosophique.
Par un réflexe de défense qui se prend pour un style de pensée.
La modernité a inventé une armure affective si légère, si glamour, si “empowered”, qu’on en oublie qu’elle empêche de respirer.
Je vois des patients épuisés d’être invulnérables, saturés d’être en contrôle, lassés de devoir performer le self-care tout en étouffant d’un manque qu’ils n’osent plus nommer.
Et certains soirs, oui — je me dis que c’est peut-être trop tard.
Que l’humain, saturé de protection, finira par se dessécher doucement comme une fleur trop longtemps recouverte de givre.
Mais il suffit parfois d’une seule scène pour que tout se redéploie.
Un silence où quelqu’un accepte de ne pas tout comprendre.
Une larme retenue puis lâchée sans commentaire.
Une phrase fragile :
« Je crois que je voudrais aimer… mais j’ai peur. »
Et là, dans ce presque rien, quelque chose recommence.
Une respiration.
Un battement.
Un désir minuscule, cabossé, mais vivant.
La psychanalyse n’a jamais promis le bonheur ; elle se contente de redonner accès au vivant, à ce qui tremble, à ce qui risque, à ce qui s’éprouve plutôt qu’à ce qui s'affiche.
Alors oui, jetons les réseaux sociaux à la poubelle — ou au moins à l’extérieur, pour une nuit, pour voir ce qu’il reste lorsque le bruit tombe et que le réel frappe à la porte. Et si, au petit matin, quelque chose en nous murmure encore « malgré tout », alors ce ne sera pas la victoire — mais ce sera déjà une renaissance.
FAQ Réseaux sociaux & psychisme : vos questions, nos réponses
Comment les réseaux sociaux abîment-ils notre rapport aux autres ?
Les réseaux créent une illusion de lien tout en installant une distance affective.
On observe souvent un mouvement défensif : juger plutôt que rencontrer, commenter plutôt qu’écouter. Ce glissement vers le cynisme — ce tout-pourri intérieur — fragilise la santé mentale et le désir. En thérapie psychanalytique ou intégrative, on restaure la présence, la nuance, le rythme humain.
Parfois, un vrai regard, en face-à-face, apporte plus que des heures à faire défiler des images sur un écran.
Les réseaux sociaux peuvent-ils rendre dépressif ?
Oui, pas toujours, mais souvent.
L’exposition au “mieux chez l’autre” et le sentiment de ne jamais faire assez alimentent tristesse, retrait, mal-être, parfois dépression.
On perd pied dans ce miroir déformant. Une rencontre avec un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute peut aider à recontacter ses propres désirs, au-delà des standards imposés. Sortir de l'écran, c’est parfois déjà respirer.
Pourquoi le cynisme augmente avec l’usage des réseaux ?
Parce qu’il devient plus facile de dire “tout est nul” que de se risquer à espérer.
Les réseaux encouragent la posture défensive : mieux vaut moquer que ressentir. On glisse vers une protection psychique qui ressemble à une cuirasse. Les approches analytique, systémique ou comportementale permettent d’interroger ce réflexe : cynisme ou peur d’être touché ? Derrière le sarcasme, il y a souvent un cœur prudent.
Comment repérer un usage problématique des réseaux ?
Si scroller remplace dormir, aimer, parler, ou simplement penser… c’est un signe.
Si l’on se sent plus anxieux, vidé, jaloux, incapable de se concentrer hors écran, il faut écouter ce signal. Ce n’est pas forcément pathologique, mais c’est un appel. Un thérapeute — TCC, humaniste ou psychanalytique — peut aider à démêler automatisme digital et besoin réel de lien.
Pourquoi les réseaux amplifient-ils l’anxiété ?
Le cerveau n’est pas fait pour absorber des signaux sociaux continus.
Notifications, jugement public, comparaison, urgence... tout active le système d’alerte interne. Résultat : agitation, ruminations, symptômes anxieux. Une relaxation, une psychothérapie ou un travail psychothérapeutique avec un praticien formé peut aider à retrouver un rythme. Parfois, apprendre à faire moins, c’est déjà se soigner.
Peut-on développer des troubles du comportement avec les réseaux ?
Oui. Impulsivité, dépendance, isolement, hypersensibilité au regard extérieur…
Les réseaux peuvent réveiller des terrains traumatiques ou des fragilités mentales. Cela ne veut pas dire qu’on “va mal”, mais qu’on est humain. Un cadre thérapeutique clair — psychanalyse, TCC, ou approche intégrative — aide à remettre du réel, du corps, du rythme, et à retrouver le goût d’être soi hors regard numérique.
Comment retrouver du désir dans un monde saturé d’images ?
Le désir renaît dans l’absence, le silence, la présence de l’autre — pas dans l’infini du scroll.
Il faut réapprendre la lenteur, le manque, la rencontre. C’est tout l’inverse du réflexe “tout-pourri”. Les thérapeutes qui travaillent le lien — psychanalystes, psychothérapeutes, praticiens humanistes — accompagnent cette réouverture. Sortir du flux, c’est redevenir sujet. Et parfois, ça commence par un simple : je pose mon téléphone.
Les réseaux sociaux peuvent-ils aggraver une fragilité psychique déjà existante ?
Oui.
Chez certaines personnes, notamment avec un terrain de souffrance psychique ou des troubles mentaux préexistants, l’exposition constante au jugement social et aux comparaisons peut agir comme un facteur aggravant. Le sujet ne “devient” pas fragile à cause d’Instagram, mais il peut voir ses défenses s’épuiser. Une psychologue clinicienne, un psychiatre ou un clinicien en psychologie clinique peut accompagner ce vécu avec finesse et prudence.
Pourquoi les réseaux sociaux intensifient-ils le sentiment de vide ?
Parce que l’instantanéité et la validation rapide créent une stimulation sans profondeur.
Le moi se nourrit d’images mais pas d’expérience intérieure. Cela peut réveiller une forme de névrose contemporaine : tout voir, ne rien sentir. Les approches psychodynamiques ou les psychothérapies plus lentes permettent de réapprendre à habiter son intériorité. Comme le rappelait déjà Freud, le désir ne se “swipe” pas : il se construit dans le manque et la rencontre.
Les réseaux sociaux peuvent-ils déclencher un traumatisme ?
Les réseaux ne créent pas systématiquement un traumatisme, mais ils peuvent le réactiver ou amplifier une blessure traumatique, surtout en cas de harcèlement numérique, d’exposition à des violences ou d’humiliation publique.
L’accompagnement peut être thérapeutique, avec des approches comportementales, psychothérapeutiques, ou une thérapie comportementale lorsque l’urgence émotionnelle domine. L’important est un cadre éthique et une vraie déontologie.
Peut-on se guérir seul d’un rapport toxique aux réseaux sociaux ?
On peut amorcer un mouvement de guérison par des limites, une discipline, une reconnexion au corps et au réel.
Mais pour certains, le retrait du numérique met à nu un vide existentiel ou une blessure plus profonde.
Dans ces cas, consulter un psychologue et psychothérapeute, un psychiatre ou un praticien en psychothérapies peut soutenir le processus. Le but n’est pas seulement d’arrêter l’écran, mais de retrouver le monde.
Les réseaux sociaux remplacent-ils l’expérience humaine du désir ?
Ils la simulent, ce qui est différent — et parfois dangereux pour le psychisme.
Ils offrent excitation, pas élan ; réaction, pas relation. Le désir se construit dans l’altérité, pas dans le miroir algorithmique. Les troubles psychiques naissent souvent de cette confusion. Les approches transactionnelle, psychodynamique ou neuro-comportementales peuvent aider à réapprendre à désirer autrement que par validation sociale. Le réel ne scrolle pas : il respire.
Comment choisir le bon professionnel si je souffre des réseaux sociaux ?
L’important est de choisir un praticien formé : psychologue clinicien, psychiatre, ou professionnel reconnu, selon la déontologie en vigueur.
Le cadre peut être psycho, psychodynamique, intégratif ou comportemental, selon votre histoire. Le plus décisif reste le sentiment d’être reçu sans jugement — signe d’un bon clinicien. Et si un jour vous vous demandez pourquoi cela vous passionne, vous êtes peut-être en train de devenir psychothérapeute de vous-même.
.webp)






