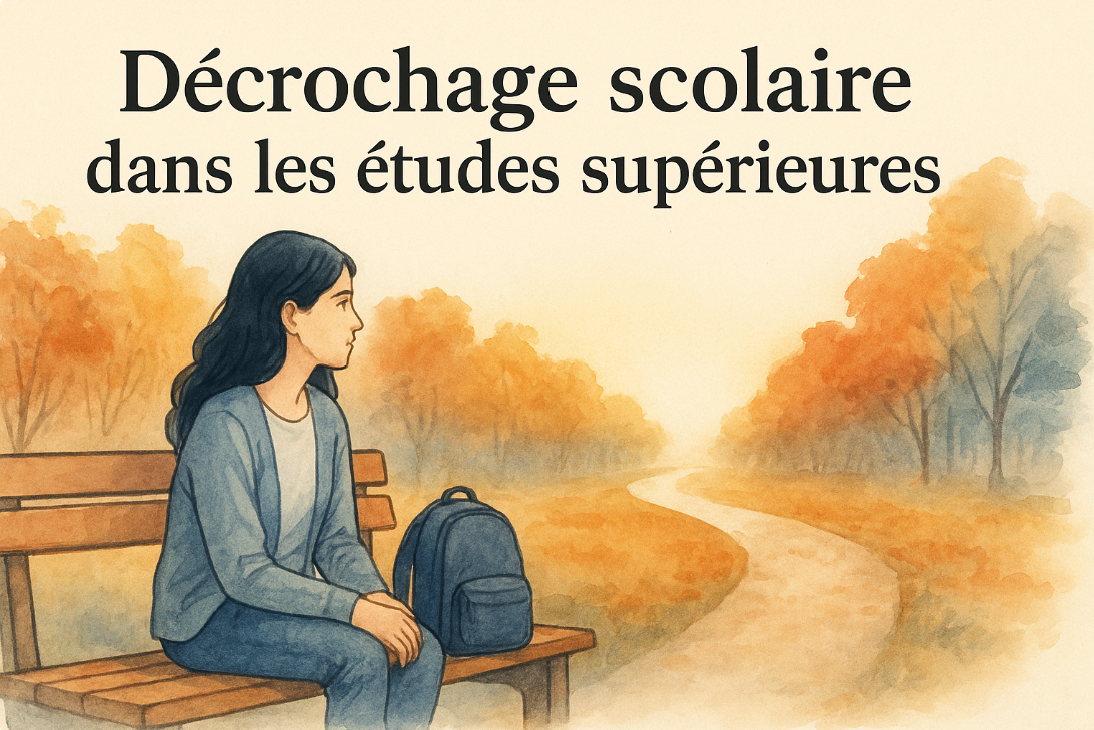Quel serait votre plus petit premier pas possible ?
On croit souvent qu’il faut tout bouleverser pour aller mieux : changer de vie, de travail, de relation, de soi. Mais la plupart du temps, la vraie transformation commence autrement — dans un geste minuscule, presque invisible, qui pourtant fait basculer quelque chose à l’intérieur. C’est un souffle, une décision discrète, une manière nouvelle de se parler à soi-même. En thérapie comme dans la vie, ce n’est pas la grandeur du pas qui compte, mais la direction qu’il prend. Et vous, quel serait votre plus petit premier pas possible ?
Je prends rendez-vous au cabinet psy à Versailles
Lorsque j’ai reçu Camille, elle s’est assise lentement, comme si le simple fait de se poser lui coûtait déjà un effort. Dans le cabinet, le silence était dense, presque saturé de fatigue. Elle m’a dit :
« Je suis épuisée. Je me sens coincée. Je voudrais changer, mais je ne sais pas par où commencer. »
Elle parlait de son travail, de son couple, de sa vie “sans joie”. Mais ce n’était pas tant l’histoire que la position du sujet qui se révélait : celle d’une femme tiraillée entre le désir de mouvement et la peur de perdre ce qui la structure. Derrière son discours d’impuissance, j’entendais surtout la terreur du vide — ce moment où tout changement devient menaçant parce qu’il équivaut, symboliquement, à une chute.
Son langage était celui du Surmoi : un flot de “il faut”, “je dois”, “je devrais déjà y arriver”. Ces formulations trahissent la présence d’un Idéal du Moi tyrannique, hérité d’une exigence parentale internalisée. Camille ne se donnait jamais le droit d’être en chemin : elle voulait être arrivée.
Alors, plutôt que d’ajouter une injonction de plus, je lui ai proposé une respiration :
« Et si, pour une fois, vous cherchiez à faire plutôt le plus petit premier pas possible ? Celui qui ne vous coûtera pas... mais vous permettra de savoir que vous êtes moins coincée... »
Elle a ri nerveusement, comme on rit d’une idée absurde. Puis, après un long silence, elle a soufflé :
« Peut-être… boire un vrai café le matin. Assise. Sans téléphone. Juste ça. »
Ce moment était insignifiant en apparence, mais il contenait un renversement symbolique : pour la première fois, Camille ne se fixait pas un objectif de performance, mais un acte de présence à soi.
Boire un café lentement devenait une expérience du réel, là où tout son psychisme vivait dans l’anticipation.
C’est souvent ainsi que s’ouvrent les cures : non pas par un bouleversement spectaculaire, mais par un geste d’humilité psychique. Le sujet accepte de ne plus “tout comprendre”, de ne plus “réussir”, mais simplement d’exister un peu mieux.
C’est ce “peu” qui change tout.
Lire aussi Petit guide du changement en 3 règles (François Roustang)
Pourquoi vouloir aller trop vite nous empêche d’avancer ?
Parce que nous avons grandi dans l’idée qu’il suffit de vouloir pour pouvoir.
« Si tu veux, tu peux » : cette maxime anodine, répétée à l’envi, a fait bien des ravages.
Elle suppose qu’un changement psychique se décide comme une résolution sportive, qu’il s’impose par la volonté. Or, la psyché n’obéit pas à la tyrannie de la performance. Elle ne se décrète pas, elle se traverse.
Aller trop vite, c’est souvent vouloir sauter le moment du doute, celui où l’on ne sait plus très bien où l’on en est. Pourtant, c’est précisément dans cet entre-deux fragile que quelque chose commence à se transformer. Freud l’avait déjà observé : la précipitation est souvent une défense contre l’angoisse. Le mouvement impulsif, le besoin de “faire quelque chose”, surgissent pour ne pas avoir à sentir. Pour ne pas affronter le vide que suppose tout changement : la perte d’une forme ancienne de soi.
Dans la cure, cette résistance prend parfois la forme d’un discours saturé de bonne volonté : « Je veux aller mieux, mais rien ne marche », « J’ai tout essayé, je ne comprends pas pourquoi ça bloque. » Ce discours, apparemment mobilisé, masque souvent une peur plus profonde : celle de lâcher le contrôle. Le Moi s’y agrippe comme à une bouée. Il voudrait changer, mais sans perdre la maîtrise, sans se confronter à l’inconnu.
Le paradoxe, c’est que cette tension empêche justement le mouvement.
L’inconscient, lui, déteste la contrainte. Il se ferme dès qu’on lui ordonne d’évoluer. Le travail thérapeutique consiste alors à rétablir une temporalité interne, une respiration du psychisme. Le plus petit premier pas possible devient, dans cette logique, une manière d’apprivoiser la peur, d’introduire du jeu entre la volonté et le lâcher-prise.
Aller trop vite, c’est vouloir faire taire l’inconscient au nom de l’efficacité.
C’est refuser le détour, le manque, la lenteur nécessaires à la symbolisation. Mais la transformation psychique ne se mesure ni en séances ni en objectifs : elle se tisse dans la patience, dans ces micro-mouvements imperceptibles où le sujet cesse de vouloir “aller mieux” pour simplement se permettre “d’aller”. Le plus petit pas possible ne contourne pas la lenteur : il l’honore. Il réconcilie le corps et la parole, le temps et le désir. Et dans cette réconciliation silencieuse, le vivant se remet doucement à circuler.
Le plus petit pas, c’est celui qui ne fait pas peur à l’inconscient
L’inconscient n’aime pas qu’on le brusque.
Il avance à son rythme, souvent en zigzag, parfois à reculons.
Toute tentative de “forcer” le changement est perçue par lui comme une menace. C’est pourquoi les résolutions trop ambitieuses échouent si souvent : elles réveillent des résistances profondes, des peurs enfouies, des zones de fragilité que la conscience voulait ignorer. Le psychisme, en somme, se protège.
Il préfère parfois l’immobilité au risque de la désorganisation.
On croit qu’il suffit de décider d’aller mieux pour que la machine suive. Mais l’inconscient ne travaille pas à l’impératif. Il se déplace par allusions, par associations, par micro-signaux. Une séance de thérapie, un rêve, un lapsus ou un silence peuvent suffire à indiquer qu’un changement est déjà en train de s’opérer, mais d’une façon qui échappe au contrôle volontaire. Le plus petit premier pas possible, dans cette perspective, n’est pas une stratégie d’action, c’est une forme de dialogue avec cette part cachée de soi : une manière de lui dire “je t’ai entendu, avançons un peu, sans te brusquer.”
La plupart des rechutes, qu’il s’agisse d’addictions, de phobies ou de comportements obsessionnels, naissent de ce décalage entre ce que l’on décide et ce que l’on peut réellement supporter psychiquement. La hâte provoque la régression. En revanche, un pas minuscule mais tolérable pour l’appareil psychique a bien plus de chances de s’inscrire durablement dans la réalité. C’est toute la différence entre le volontarisme et l’ajustement symbolique. Le premier s’impose de l’extérieur — “il faut que je change, que je fasse, que je réussisse” — tandis que le second vient de l’intérieur, comme un consentement subtil, presque organique. Ce que le sujet accepte, il ne le subit plus. Il devient auteur du mouvement.
En ce sens, le plus petit premier pas possible n’est pas un compromis, mais une forme de bienveillance envers l’inconscient. C’est un signe de confiance. C’est dire à la peur : “Je ne t’élimine pas, je t’emmène avec moi.” Car l’inconscient, lorsqu’il se sent écouté plutôt que contraint, se remet à coopérer. Et ce qui semblait impossible hier devient, sans qu’on sache comment, étrangement accessible aujourd’hui.
Changer, c’est toujours négocier avec l’invisible.
On croit qu’on avance vers un but ; en réalité, on réapprend à se laisser traverser. C’est dans cette docilité paradoxale, dans cette écoute du tempo intérieur, que se loge le véritable courage thérapeutique : celui de ne pas forcer, mais de suivre — pas à pas — le rythme singulier de son propre inconscient.
Lire aussi Si vous voulez que quelque chose change, changez quelque chose !
Le changement n’est pas une ligne droite
On imagine souvent le changement comme un trajet bien balisé, une route à suivre pas à pas, du “problème” vers la “solution”.
Mais dans la réalité psychique, rien n’est jamais linéaire.
Le mouvement intérieur ressemble plutôt à une spirale : on croit s’éloigner, puis on revient, autrement. Le symptôme se déplace, la douleur se reformule, le désir se cherche de nouveaux chemins. C’est ainsi que le psychisme travaille : par boucles, détours et reprises.
En séance, on observe ce paradoxe : plus le patient veut aller droit au but, plus il s’en éloigne. La psyché a besoin de temps pour métaboliser l’expérience. L’inconscient n’avance pas à la manière d’une flèche, mais d’une marée. Il se retire, revient, hésite, explore, recommence. Les progrès visibles ne sont souvent que la pointe émergée d’un lent travail souterrain. C’est pourquoi le plus petit premier pas possible a tant de valeur : il ne promet pas un miracle, mais il amorce le mouvement. Il reconnaît la complexité du changement, son caractère imprévisible. Il ne cherche pas à “réparer”, mais à remettre en circulation quelque chose qui s’était figé.
Changer, c’est aussi accepter de ne pas toujours “aller mieux”.
Il y a des moments de fatigue, de doute, de découragement. On recule un peu, on répète, on s’agace. Mais ces retours ne sont pas des échecs : ils font partie du processus. Comme dans la psychanalyse, la répétition n’est pas un obstacle, mais une tentative de symbolisation. Le sujet revient sur le même point, encore et encore, jusqu’à pouvoir y inscrire un sens nouveau. C’est pourquoi les pas minuscules sont souvent les plus puissants : ils se déposent dans la durée, ils n’effraient pas la psyché, ils la nourrissent.
Dire une phrase autrement, respirer avant de répondre, se taire au lieu de se justifier — voilà des gestes minuscules qui, dans le champ du psychique, valent des révolutions.
Le changement véritable ne ressemble pas à une conquête, mais à une traversée. Il ne consiste pas à “se débarrasser” de l’ancien, mais à lui donner une autre forme, à le relier autrement. La ligne droite est un fantasme rationnel ; la transformation psychique, elle, est un tissage vivant, imprévisible, organique. Apprendre à ne plus mesurer son avancée en performances, mais en souplesse intérieure, c’est déjà se libérer. Accepter de ne pas savoir exactement où l’on va, mais de sentir qu’on y va, c’est peut-être cela, le vrai progrès : une confiance silencieuse dans la direction du vivant.
Je prends rendez-vous au cabinet psy à Versailles
Le plus petit pas, c’est souvent celui qu’on croit inutile
Il arrive que le changement commence sans qu’on le reconnaisse.
Un détail, un geste, un choix anodin : rien de spectaculaire, rien qui mérite qu’on le raconte.
Et pourtant, c’est souvent là que tout se joue. L’inconscient, dans sa sagesse discrète, ne supporte pas les révolutions éclatantes. Il se déploie à bas bruit, dans l’infime, dans l’interstice du quotidien.
Ce qu’on croit inutile — respirer avant de parler, différer une réponse, oser dire non, ou simplement ne rien dire — est parfois un acte psychique majeur. Ces micro-décalages viennent fissurer l’automatisme, faire vaciller le scénario intérieur qui semblait immuable. Loin d’être anodins, ils marquent l’apparition d’un espace symbolique : un intervalle entre le vécu et la réaction, entre la pulsion et l’acte. C’est dans cet intervalle que la liberté psychique s’invente.
Beaucoup de patients s’excusent de “ne pas avoir avancé”, parce qu’ils n’ont pas “fait” grand-chose depuis la dernière séance.
Mais avancer, en thérapie, ne se mesure pas en kilomètres. Parfois, ce n’est pas le corps qui bouge, mais la représentation interne. Un rêve, une prise de conscience fugace, une émotion retrouvée suffisent à faire basculer le rapport du sujet à lui-même. Ce sont des pas invisibles, mais décisifs.
Freud disait déjà que “le travail du rêve” est une manière de penser autrement, sans la logique consciente. Le plus petit pas possible, c’est cela : un déplacement du sens, souvent imperceptible, mais irréversible. Une part de soi cesse de lutter, une autre commence à respirer.En réalité, ce que nous jugeons inutile l’est souvent à l’échelle de l’ego, pas de la psyché. L’ego veut du résultat, du visible, du concret. L’inconscient, lui, se satisfait d’un mouvement. Il se nourrit de la nuance, du presque rien, du détour qui n’en est pas un. La lenteur n’est pas une perte de temps : elle est un temps de maturation. Ce que la conscience croit être un “retard” est souvent un passage obligé, une incubation du sens.
Le plus petit pas, celui qu’on fait sans y croire vraiment, celui qu’on accomplit parce qu’on n’a plus la force de résister, peut devenir le point de bascule. Ce geste infime — boire un café en silence, écrire quelques mots, sortir marcher dix minutes — n’a rien d’héroïque. Et pourtant, c’est là que se loge l’héroïsme véritable : celui de la continuité, de la fidélité au mouvement, de la foi dans le processus.
Changer, au fond, ce n’est pas tout transformer.
C’est commencer à vivre différemment dans la même vie. C’est se donner la permission d’habiter un peu mieux le réel, sans chercher à le fuir ni à le réinventer. Et ce “peu” suffit souvent à déplacer tout l’équilibre.
Et vous, quel serait votre plus petit premier pas possible ?
Il y a toujours un moment où la question se retourne vers soi.
Où l’on cesse de lire, d’écouter, d’attendre, pour se demander : “Et moi, quel serait mon plus petit premier pas possible ?” Pas le plus ambitieux, pas le plus exemplaire. Juste celui qui serait possible aujourd’hui, dans la vérité de ce que je suis.
Ce pas, pour certains, ce sera oser demander de l’aide, pour d’autres, accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Ce peut être prendre rendez-vous, écrire une phrase, marcher dix minutes, ou simplement respirer sans but. Rien qui change le monde — mais tout ce qui change la manière de l’habiter. Le plus petit premier pas, c’est une manière de dire oui à la vie, mais à voix basse. Ce n’est pas un “je vais mieux”, c’est un “je me remets en route”. C’est le moment où la paralysie cède un peu, où quelque chose du vivant, même infime, se remet à circuler.
En thérapie, ce pas-là n’a rien d’anodin : il marque le passage du vouloir comprendre au vouloir exister. Il ne s’agit plus d’avoir une explication, mais une expérience. Le sujet cesse de se raconter en boucle pour commencer à se rencontrer. Et cette rencontre, toujours inédite, se fait souvent dans les interstices les plus modestes du quotidien.
Faire ce premier pas, aussi minuscule soit-il, c’est reconnaître qu’on n’a plus besoin d’attendre d’être prêt pour commencer. Car le changement ne naît pas de la certitude, mais du mouvement. Ce n’est pas le pas qui doit être grand, c’est le lien avec soi qui doit être vrai.
Alors, aujourd’hui, sans vous juger ni vous presser, demandez-vous simplement : quel geste, aussi discret soit-il, pourrait rouvrir un peu l’espace du possible ? Il n’a pas besoin d’être visible. Il suffit qu’il soit sincère. C’est souvent de là que tout repart : du minuscule, du presque rien, du premier pas qui semble ne mener nulle part — mais qui, symboliquement, change tout.
Je suis avec vous...
Je prends rendez-vous au cabinet psy à Versailles
FAQ – Le plus petit premier pas possible en thérapie
Pourquoi est-il si difficile de changer, même quand on le veut vraiment ?
Changer semble simple en apparence, mais sur le plan psychologique et psychanalytique, cela suppose de renoncer à une part de soi.
Le Moi s’accroche à ce qu’il connaît, même lorsque cela fait souffrir. Derrière la résistance, il y a souvent un refoulement inconscient : une peur, une culpabilité, parfois un traumatisme non symbolisé. Le rôle du thérapeute ou du psychothérapeute est d’accompagner ce mouvement sans le forcer, en permettant au patient d’apprivoiser son propre rythme de guérison émotionnelle. Le plus petit premier pas possible devient alors un acte d’écoute envers soi-même.
En quoi un tout petit changement peut-il avoir un effet profond sur la psyché ?
Un geste minime agit comme un signal adressé à l’inconscient : “je peux bouger sans me perdre”.
Dans une perspective freudienne, ce micro-déplacement modifie l’économie des pulsions, apaise les mécanismes de défense et permet à l’énergie psychique de circuler différemment. Ce n’est pas la taille du changement qui compte, mais sa portée symbolique. Le praticien analytique ou clinicien aide à donner sens à ces mouvements imperceptibles, souvent déclencheurs d’un processus psychothérapeutique plus large. Ce “peu” crée parfois les plus grandes transformations.
Le plus petit premier pas possible s’applique-t-il à tous les types de troubles ?
Oui, qu’il s’agisse d’une phobie, d’une névrose, d’un état dépressif, d’un traumatisme ou d’un trouble anxieux, le principe reste valable.
Dans tous les cas, l’objectif est de réduire la charge de la contrainte interne pour réintroduire du possible. Ce pas modeste respecte la temporalité psychique, souvent mise à mal dans les troubles comportementaux ou psychosomatiques. Le psychanalyste, le psychothérapeute ou le psychiatre soutient ce processus en aidant le sujet à tolérer la lenteur et à reconnaître que la guérison n’est pas une performance, mais un ajustement progressif du psychisme à la réalité.
Quelle différence entre un accompagnement psychanalytique et comportemental quand on veut changer ?
L’approche comportementale agit sur les comportements observables : on apprend à modifier une habitude, à désamorcer une peur, à reprogrammer des réactions. L’approche psychanalytique explore les causes profondes du blocage : les désirs refoulés, la culpabilité inconsciente, les traumatismes infantiles, les mécanismes de défense. L’un ne remplace pas l’autre : ils se complètent. Le thérapeute intégratif peut articuler ces approches pour accompagner à la fois la dimension corporelle, émotionnelle et psychique du changement. Ce qui importe, c’est de trouver la voie qui respecte la singularité du sujet.
Comment savoir si je fais vraiment un pas, ou si je tourne en rond ?
Tourner en rond fait souvent partie du processus de changement.
Le courant psychanalytique nous enseigne que la répétition n’est pas inutile : elle prépare une mutation du sens. Ce qui semblait stérile devient fécond dès lors qu’il est compris comme une tentative de l’inconscient de se dire autrement. Le clinicien ou analyste freudien aide le patient à distinguer la répétition défensive de la répétition élaborative. Si le vécu change — même légèrement — le pas est réel. Le progrès n’est pas toujours spectaculaire, mais il est toujours signifiant.
Le plus petit pas possible suffit-il à guérir d’un traumatisme ?
Un traumatisme ne se “guérit” pas, il se transforme.
Il devient moins envahissant, moins douloureux. Le plus petit pas possible — parler, écrire, oser ressentir, demander de l’aide — ouvre un espace de sécurité où l’expérience traumatique peut être enfin mise en mots. Le travail analytique, parfois soutenu par une approche neuropsychologique ou corporelle, permet de reconnecter ce qui avait été dissocié. Le psychanalyste ou le psychothérapeute aide le sujet à apprivoiser le souvenir sans s’y noyer. Le mouvement est lent, mais c’est ainsi que s’opère la véritable guérison psychique.
Le changement psychique peut-il se faire sans accompagnement thérapeutique ?
Certains changements naissent spontanément d’une prise de conscience, d’un choc émotionnel, ou d’une maturation naturelle.
Mais un accompagnement psychothérapeutique offre un cadre symbolique, un miroir et une continuité. Le thérapeute ou psychanalyste y occupe la place d’un témoin du processus, garant du sens et du rythme. Là où l’on risquerait de retomber dans l’ancien, la présence d’un praticien aide à tenir le fil. La psyché ne guérit pas seule, mais en lien. Le plus petit pas possible prend alors la valeur d’un engagement envers soi-même — et envers l’autre qui écoute.
.webp)
.webp)