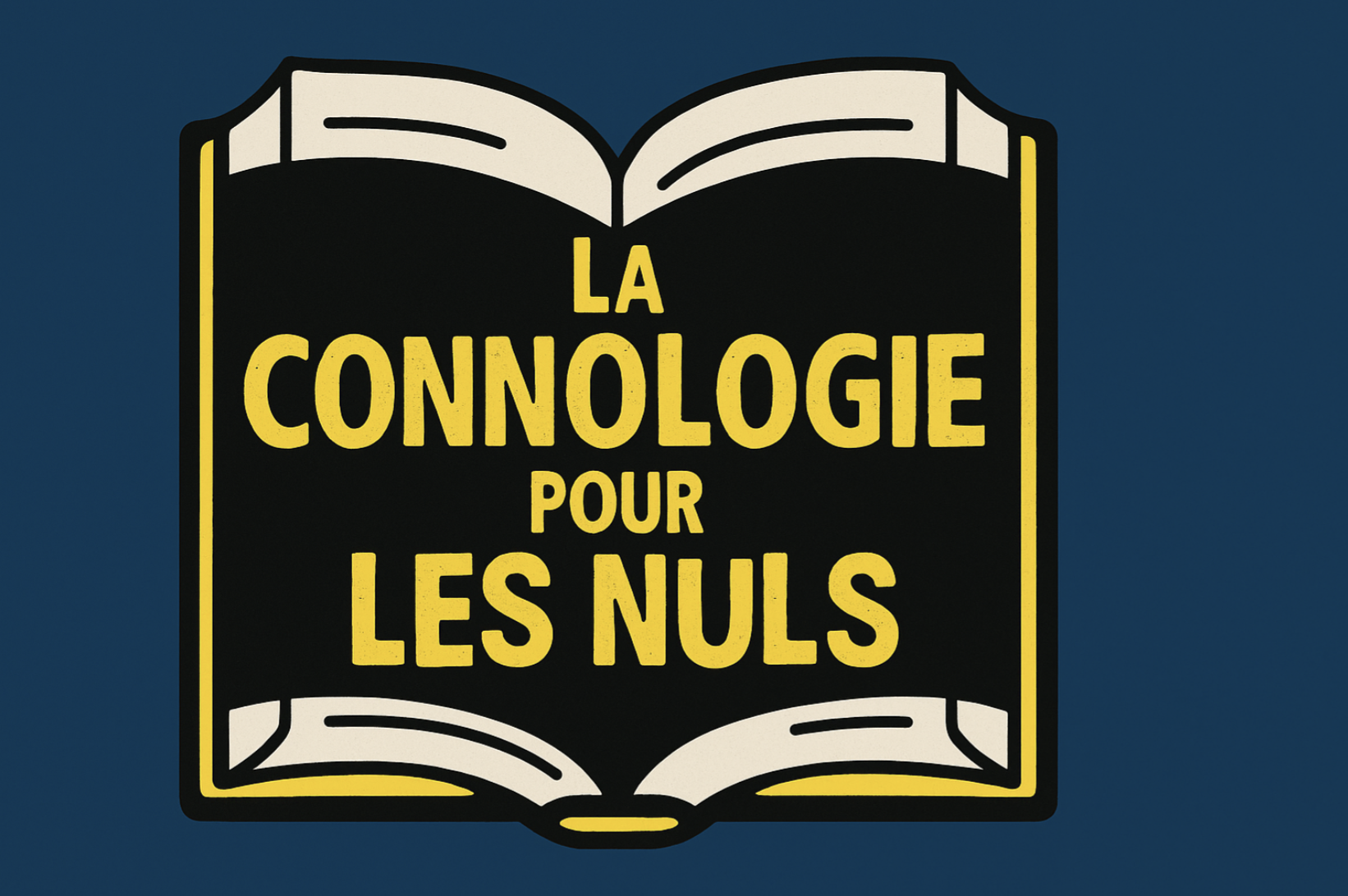
Pour une science appliquée de la connerie...
« La psychanalyse est un remède contre l’ignorance. Elle est sans effet sur la connerie. » Jacques Lacan... Nous sommes tous le con de quelqu’un. Et, il faut bien le dire, les cons sont partout : au travail, dans les administrations, dans les familles, sur les routes, à la caisse du supermarché, et même, parfois, dans les cabinets psy. J’ai récemment eu l’occasion d’en croiser un spécimen particulièrement inspirant, que je remercie — sincèrement — pour l’idée de cet article. Car si la psychanalyse ne prétend pas soigner la connerie, elle peut, au moins, l’observer à la loupe. Un clin d’œil ici à Jean-François Marmion, qui signe dans Sciences Humaines, un article jubilatoire intitulé La connologie pour les nuls. Il y défend, non sans ironie, l’idée d’une discipline à part entière, rigoureuse et nécessaire, pour appréhender les comportements absurdes, bornés ou toxiques qui peuplent notre quotidien. Une science de la bêtise appliquée. Une clinique de la connerie sociale. Et un champ de recherche qui, à défaut d’être reconnu par l’Académie des Sciences, mériterait au moins un observatoire national. Alors, plutôt que de m’indigner, j’ai préféré contribuer. Voici donc ma modeste pierre à l’édifice de la connologie, version psychanalytique, stratégique et… résolument pratique. Bienvenue dans le monde fascinant, épuisant, parfois comique — et souvent tragique — de la connologie. Bonne lecture.
Qu’est-ce qu’un con, au sens psychanalytique ?
Le con, au sens psychanalytique, n’est pas (seulement) celui qui dit des bêtises ou manque de culture.
Le con, c’est celui qui se bouche à l’inconscient.
Il érige sa certitude en rempart, son bon sens en dogme, et son ignorance en vertu. Il ne doute pas, il assène. Il ne se questionne pas, il explique. Il ne se déplace jamais subjectivement — et pour cause : il est tout entier logé dans le moi.
Or, chez Lacan, le Moi, c’est l’instance de la méconnaissance. C’est le faux self, le miroir, la comédie. Et le con, c’est justement celui qui prend son reflet pour une essence, sa pensée pour la Vérité. Il confond le réel et ses opinions, l’Autre et ses fantasmes. Il ne cherche pas à comprendre : il veut avoir raison.
Lacan disait encore que « le con, c’est celui qui croit qu’il n’est pas pris dans le discours. » Autrement dit : il s’exclut du langage comme s’il en était le maître. Il ne parle pas, il décrète. Il ne fait pas entendre un symptôme, mais un ordre. Il jouit de la parole comme d’un pouvoir, jamais comme d’un lien.
Le con est donc une figure du refus
S’il fallait une définition « cliniquement utile » du con, ce serait peut-être celle-ci : celui qui refuse.
Non pas par lucidité, ni par prudence. Mais par rigidité défensive. Par incapacité à composer avec ce qui dépasse, déplace, ou dérange.
Derrière son apparente assurance, sa raideur ou son autorité, le con se protège. Contre quoi ? Contre quatre dimensions fondamentales de l’existence psychique : l’altérité, le manque, l’énigme et le désir.
• Refus de l’altérité
Le con n’écoute pas. Il supporte mal ce qui est autre que lui : une opinion différente, une culture étrangère, une émotion non conforme.
L’altérité, au fond, le met en péril. Elle le force à se remettre en question, à reconnaître qu’il n’est pas le centre du monde.
Mais plutôt que de rencontrer l’autre, il cherche à le faire taire, le contrôler, le rabaisser — ou l’exclure.
Le con ne dialogue pas : il monologue en boucle.
• Refus du manque
Là où l’être humain mature accepte d’être incomplet, le con fait comme s’il savait tout, avait tout, comprenait tout.
Reconnaître un manque, c’est accepter une faille en soi — or, c’est précisément ce que la structure du con nie à tout prix.
Il compense : par le savoir pseudo-maîtrisé, par l’autorité, par des réponses toutes faites. Il préfère une bêtise affirmée à un doute sincère.
Freud disait que la reconnaissance du manque est le début du travail psychique. Le con, lui, refuse de travailler.
• Refus de l’énigme
Le monde est complexe. Les humains aussi. Mais pour le con, tout doit être clair, net, sans nuance ni trouble.
Les émotions, il les range. Les contradictions, il les nie.
Ce qu’il ne comprend pas, il le méprise. Ce qu’il ne peut pas classer, il l’écrase.
C’est pourquoi il hait la poésie, la psychanalyse, et parfois même… le regard d’un enfant.
L’énigme le confronte à ses limites. Et le con ne supporte pas les limites.
• Refus du désir
Désirer, c’est reconnaître une tension, une ouverture vers l’autre, une attente jamais comblée tout à fait.
Mais le con, lui, veut des choses, pas du désir. Il consomme, il exige, il obtient — ou il sanctionne.
Le désir l’inquiète : il est imprévisible, trop vivant. Il le remplace par la norme, le devoir, ou le pouvoir.
Il se fait gardien de l’ordre, tout en restant étranger à sa propre subjectivité.
Là où le désir cherche une voie, le con cherche une issue. Définitive. Fermée. Binaire.
Mais attention : tous les cons ne se ressemblent pas. Il y a le con dominateur, le con borné, le con séducteur, le con passif-agressif, le con hiérarchique, le con de comptoir, le con éclairé (celui qui a tout lu, sauf son inconscient), et bien sûr : le con content de lui.
Celui-là est indécrottable.
Il ne tombera jamais malade — puisqu’il croit être la santé incarnée.
Il ne fera jamais de thérapie — puisqu’il est persuadé de n’avoir aucun symptôme.
Et surtout, il ne cèdera jamais sur sa jouissance.
Bref : le con est une structure fermée.
« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine… mais en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. » — Albert Einstein
Comment repérer un con ? (Petit manuel de survie)
Vous en croisez tous les jours.
Mais le con ne se repère pas à son QI, ni à ses fautes d’orthographe, ni même à ses opinions politiques. Non.
Le con se reconnaît à son rapport à la parole. Il ne parle pas pour ouvrir, il parle pour fermer. Il coupe, interrompt, simplifie, ironise — toujours pour évacuer l’ambiguïté, cette étrangeté qu’il ne supporte pas.
Voici quelques symptômes cliniques de la connerie ordinaire :
- Il répond toujours à côté, mais avec aplomb.
Ce n’est pas qu’il n’a pas compris la question. C’est qu’il ne s’est même pas donné la peine de l’entendre. Il répond à ce qu’il croit avoir entendu — ou à ce qu’il avait envie de dire depuis trois jours.
- Il confond l’agressivité avec la franchise, et la domination avec le charisme.
Il dit les choses « cash », croit faire preuve de courage alors qu’il fait surtout preuve d’insensibilité, voire de brutalité. Il appelle ça « dire les choses », mais oublie qu’il faudrait d’abord les penser.
- Il vous explique votre propre métier, sans jamais vous avoir demandé quoi que ce soit.
Il connaît tout. En mieux. Il est spécialiste de ce que vous avez étudié pendant dix ans, à la faveur d’un tuto YouTube ou d’un déjeuner avec son cousin. Pire : il vous corrige.
- Il croit que son expérience personnelle vaut preuve universelle.
« Moi, j’ai fait comme ça et ça a marché. Donc c’est comme ça qu’il faut faire. » Voilà. CQFD.
Le con ne croit pas aux statistiques, ni aux faits, ni à la science. Il croit à lui.
- Il prend votre silence pour une faiblesse, et vos nuances pour de la confusion.
Vous réfléchissez ? Vous hésitez ? Vous cherchez vos mots ? Pour lui, c’est que vous êtes perdu.
Il ne sait pas qu’on peut se taire par intelligence, et nuancer par rigueur.
- Il ne supporte pas de ne pas avoir le dernier mot.
Quitte à l’inventer. Ou à redire ce qu’il a déjà dit, mais plus fort. Ou plus bête. Il préfère un point final médiocre à une virgule prometteuse. Le con est allergique à la suspension.
- Il parle pour ne pas penser, et pense pour avoir raison.
La parole est pour lui un outil de conquête, pas de rencontre. Il ne débat pas : il gagne ou il perd. Et s’il perd… c’est que vous êtes con.
- Il ne change jamais d’avis. Mais il peut changer de sujet.
Le con est d’une constance remarquable : il a tort, mais il insiste. Il est parfaitement imperméable à la contradiction — sauf si elle vient d’un supérieur hiérarchique.
- Il vous contredit... puis vous répète, dix minutes plus tard, comme si c’était son idée.
Et il vous regarde avec l’air de celui qui vient de résoudre une équation impossible.
Le con recycle. Il pille. Il oublie que vous avez parlé. Et parfois même, il vous remercie.
Mais attention : certains cons sont très polis. Ce sont des cons stratégiques. Ils sont capables d’écouter, mais seulement pour mieux vous rabattre leur « bon sens » en pleine figure au moment opportun. Ce sont des agents dormants du Moi. Toujours prêts à dégainer un « oui mais », un « vous savez, moi je suis pragmatique », ou pire : un « c’est pas compliqué ».
Le con ne vous entend pas. Il vous évalue.
Les 7 grandes familles de cons
Petit précis d’anthropologie contemporaine appliquée
1. Le Con sûr de lui (et c’est bien ça le problème)
Il ne doute jamais. Il ne demande jamais. Il sait. C’est même sa signature principale : la certitude. Ce qu’il avance est vrai, parce qu’il le pense. Il est son propre argument. Il aurait pu être scientifique, mais il a préféré être péremptoire.
2. Le Con stratège (mais à très courte vue)
Il pense manipuler, tirer les ficelles, tirer profit de tout. Mais il ne voit jamais plus loin que le bout de son intérêt personnel. Il croit que ruser, c’est être intelligent. En réalité, il se prend pour Machiavel avec le niveau stratégie de Candy Crush.
3. Le méchant Con (qui se croit juste “cash”)
Il pique, il rabaisse, il ridiculise. Il appelle ça « être franc ». Il humilie les autres sans jamais ressentir la moindre empathie. Parfois, il cache sa cruauté sous des sourires cordiaux. Mais à la fin, il fait mal — et prétend que vous l’avez mal pris.
4. Le Con sentencieux (qui croit que Twitter est une chaire de philosophie)
Il parle par slogans, pense par proverbes et vous assomme de certitudes génériques. Il cite souvent des auteurs qu’il n’a pas lus pour avoir le dernier mot, avec des perles du type : « Comme disait Einstein, la folie c’est de refaire toujours la même chose et d’attendre un résultat différent ». Spoiler : Einstein n’a jamais dit ça.
5. Le Con victime (qui retourne tout contre vous)
Rien n’est jamais sa faute. Il est mal compris, persécuté, jugé trop vite. Il inverse les rôles avec virtuosité : vous signalez une limite, il vous accuse de violence. Vous posez un cadre, il pleure à l’injustice. Un chef-d’œuvre de retournement projectif.
6. Le Con besogneux (mais envahissant)
Il ne sait pas faire, mais il est là. Il encombre l’espace, ralentit le groupe, pollue la dynamique. Mais il est souvent promu. Parce qu’il est là depuis longtemps. Parce qu’il connaît les codes. Parce qu’il ne fait pas de vagues. C’est un con d’habitude.
7. Le Con décoratif (mais nuisible quand même)
Il sourit, dit bonjour, parle de la météo. On pourrait croire qu’il est inoffensif. Mais sa connerie passive fait écran à tout ce qui dérange. Il valide les abus par son silence, protège les plus toxiques par son inertie. Le con complice, poli et bien élevé.
La connerie selon les experts : quand la bêtise devient système
Comme l’écrit Jean-François Marmion, psychologue et auteur de La Psychologie de la connerie (2018), « la connerie est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls imbéciles ». Sous sa plume, le terme désigne moins une déficience intellectuelle qu’un aveuglement actif, une persistance dans l’erreur nourrie d’orgueil, d’ignorance volontaire et de certitudes rigides.
C’est cette forme de stupidité militante, presque assumée, que nous rencontrons au quotidien : dans nos relations, nos institutions, nos administrations… et parfois même à la caisse du supermarché.
Pourquoi la connerie est-elle si résistante à la psychanalyse ?
Parce que le con ne veut rien savoir de ce qui le dépasse.
Il ne veut pas être troublé.
Il veut avoir raison et que ça cesse. Il est dans la clôture narcissique, le confort moïque, le déni du manque. La psychanalyse, elle, part du manque, du raté, de l’insupportable — du symptôme. Or le con n’a pas de symptôme. Il a des certitudes.
Lacan l’a formulé clairement :
« La psychanalyse est un remède contre l’ignorance. Elle est sans effet sur la connerie. »
Pourquoi ? Parce que l’ignorant peut encore être enseigné. Le con, lui, est vacciné contre le savoir.
Il est dans le refus radical de l’énigme, dans l’arrogance blindée de celui qui n’a jamais douté de sa position subjective. Le savoir de l’inconscient le laisse froid. Ce qu’il aime, c’est la règle, le cadre, la punition pour les autres — et les passe-droits pour lui.
La connerie, c’est donc le nom d’un refus de subjectivation. Le con refuse le transfert, refuse le déplacement, refuse l’altération. Il vit dans une identification primaire à l’ordre, au moi, au rôle. Il ne dit jamais « je ne sais pas ». Il dit : « moi je », « moi je sais », « moi à votre place », et surtout : « vous devriez ».
Autrement dit : la connerie, c’est le Nom-du-Père sans désir. Une loi morte. Une voix sans sujet.
Peut-on guérir un con ?
Spoiler : non.
La connerie n’est pas une maladie. C’est une structure.
Et même plus : une vocation. Être con, c’est choisir de ne jamais se remettre en question. C’est refuser l’angoisse de la division subjective en se lovant dans le confort d’une pensée binaire, pavée de certitudes, de principes creux et de maximes autoritaires.
Le con ne demande pas d’aide. Il n’écoute pas les réponses, et surtout : il ne pose pas de questions. Car demander, ce serait s’exposer. Et le con ne s’expose jamais. Il se protége par l’ironie, le sarcasme ou la rigidité morale. Il joue à l’enseignant, à l’expert, au justicier — parfois même à l’humoriste. Mais il ne descend jamais de scène.
Il n’a pas d’angoisse de castration : il est entier, indéboulonnable, hermétique.
On ne guérit pas ce qui ne saigne pas.
On ne désaliène pas celui qui jouit de sa chaîne.
Le travail psy suppose un minimum de faille, un début de désir, un soupçon d’inquiétude. Autant dire : un terrain vierge pour la connerie. Le con, lui, n’a pas besoin d’analyse. Il a Facebook.
La jouissance du con : pourquoi il aime tant emmerder les autres ?
Parce que le con jouit de faire plier l’autre.
Il se nourrit de sa capacité à vous faire perdre du temps, de l’énergie, de la patience. Ce n’est pas un sadique, non. C’est un fonctionnaire du malaise. Il applique une logique, une règle, une idée fixe — au mépris du vivant.
Il n’a pas besoin d’avoir raison. Il a besoin que vous cédiez.
Et s’il vous met mal à l’aise, c’est gagné.
S’il vous fait douter de vous, il est exalté.
S’il provoque en vous une colère que vous n’exprimez pas, il triomphe en silence.
Le con est donc un petit preneur d’otages symboliques.
Il installe son discours dans vos oreilles, sa logique dans vos nerfs, sa morale dans vos tripes. Et il vous regarde vous débattre, persuadé qu’il est, lui, du bon côté.
Le plus terrible ? Il est parfois sincère.
Il croit vraiment bien faire.
Il croit vraiment que vous êtes l’agresseur parce que vous lui résistez.
Il croit même parfois qu’il vous sauve.
C’est pourquoi le con est, au fond, tragique.
Il jouit d’une position imaginaire sans jamais accéder à son désir.
Il répète, impose, régente — mais ne désire rien.
Il imite l’autorité sans jamais en porter la responsabilité.
En conclusion : une clinique de la connerie ?
La connerie n’est pas un défaut. C’est une stratégie d’existence.
Une manière de ne pas penser, de ne pas douter, de ne pas désirer — bref, de ne pas souffrir. En cela, elle mérite d’être lue non comme une pathologie, mais comme une défense ultime contre l’insupportable complexité du réel.
Lacan disait :
« La psychanalyse est un remède contre l’ignorance, elle est sans effet sur la connerie. »
Et pour cause : la connerie est imperméable à l’analyse.
Elle ne s’écoute pas, elle s’épanche. Elle ne cherche pas, elle assène. Elle ne questionne pas, elle commente. Elle prend toute la place, non pas par excès d’ego, mais par vide d’être.
Alors que faire ?
Pas grand-chose.
Ne pas répondre, parfois. Ne pas se justifier, souvent. Et toujours, rester du côté du désir.
Car ce qui distingue fondamentalement le con de celui qui ne l’est pas, ce n’est pas le niveau intellectuel, ni la culture, ni même l’intelligence relationnelle. C’est la capacité à se remettre en cause.
À dire : « Et si j’avais tort ? »
À entendre : « Je ne suis pas sûr. »
La connerie, elle, n’a jamais tort.
Elle triomphe d’avance.
Mais elle ne jouit que d’elle-même. Ce qui est, au fond, sa malédiction.
.webp)






