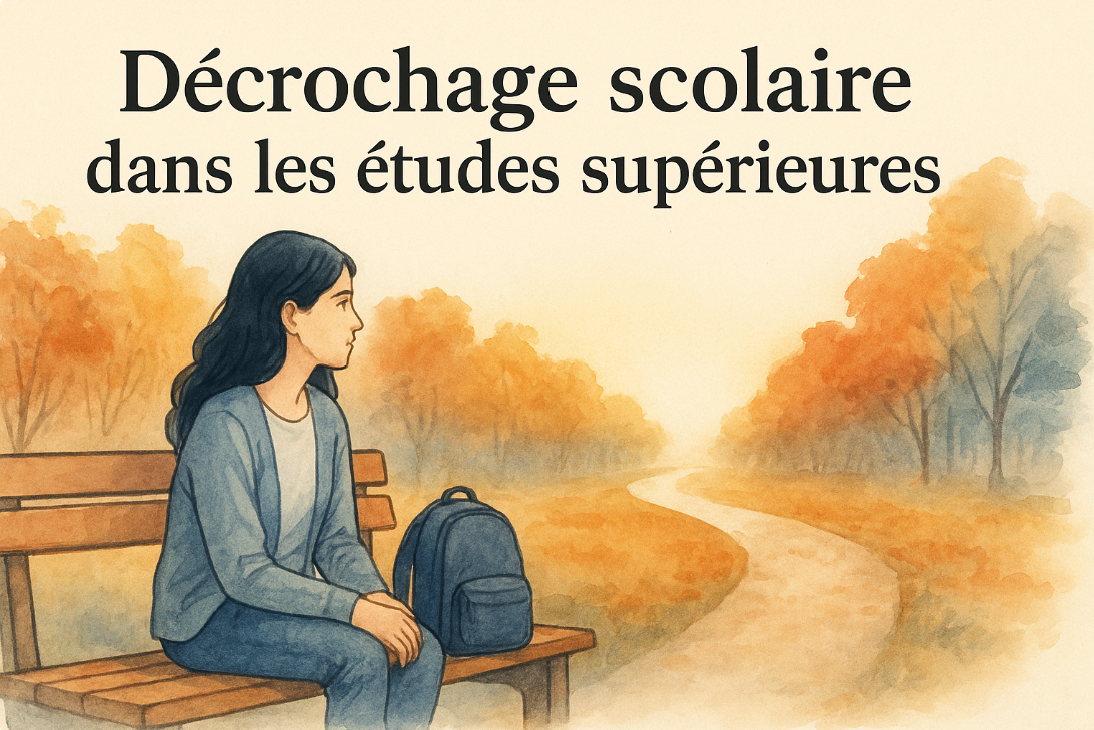
Décrochage scolaire dans les études supérieures : comprendre, prévenir, rebondir
Le décrochage scolaire dans les études supérieures ne se résume pas à un échec : il révèle souvent un malaise psychologique, une crise existentielle, ou une inadaptation du parcours à la personnalité de l’étudiant. Anxiété, burn-out universitaire, perte de motivation, troubles de la concentration, manque de confiance ou pressions familiales : les causes sont multiples. Heureusement, il est possible d’en sortir grâce à un accompagnement thérapeutique et coaching personnalisé, intégrant parfois hypnose, EMDR ou travail sur la motivation. Allez, c’est parti…
Pour toute question ou pour débuter un accompagnement, prendre contact facilement et en toute confidentialité.
Lorsque j’ai reçu Camille, 20 ans, étudiante en licence de biologie, elle venait de tout abandonner. « Je ne sais plus pourquoi je fais ça », m’a-t-elle dit d’une voix blanche. Elle se levait chaque matin avec la sensation d’être vide, de ne pas être « à sa place ». Derrière ce décrochage universitaire, se cachait une fatigue psychique profonde, une perte de sens, et surtout une immense culpabilité : celle d’avoir « déçu » ses parents et ses professeurs.
Camille n’était pas seule. Chaque année, des milliers d’étudiants vivent ce même désarroi silencieux.
"Ce n’est pas l’échec qui brise, c’est le regard que l’on pose sur lui." Boris Cyrulnik
Lire aussi Études supérieures : 4 clés pour s’adapter et réussir grâce au coaching
Pourquoi tant d’étudiants décrochent dans le supérieur ?
Le décrochage n’arrive pas d’un coup.
Il commence souvent dans un chuchotement intérieur, un petit “je n’ai plus envie” qu’on balaie d’un revers de main. Puis les absences s’enchaînent, les réveils deviennent lourds, les cours s’effacent dans une brume de fatigue et de doutes.
Ce n’est pas la paresse, c’est l’épuisement du sens. Le moment où le corps dit stop avant que la tête comprenne pourquoi.
Beaucoup d’étudiants quittent le lycée en croyant franchir une porte vers la liberté. En réalité, ils entrent dans un espace sans murs, sans repères, où l’autonomie se vit comme une chute libre. Le supérieur ne protège plus, il expose. On ne vous appelle plus par votre prénom, on ne vous attend plus. Vous êtes seul face à l’immensité de ce qu’il faut devenir.
Et la solitude, à cet âge, mord fort.
Le mot “décrochage” sonne comme une chute, mais il décrit souvent une lente dérive. Un glissement silencieux vers un vide intérieur, nourri par la pression, la comparaison, la peur de l’échec. Certains étouffent sous la performance, d’autres se dissolvent dans l’indifférence. Les étudiants d’aujourd’hui n’ont pas seulement à apprendre : ils doivent exister dans un monde saturé d’attentes.
Pour beaucoup, l’université devient une scène où ils ne savent plus quel rôle jouer. On leur a dit qu’ils étaient brillants, mais pas comment supporter le doute. On leur a appris à viser haut, mais pas à traverser les chutes.
Le décrochage, c’est parfois le cri du corps quand l’âme ne trouve plus sa place. Des insomnies, une anxiété qui serre la gorge, une incapacité à se concentrer. La souffrance est réelle, mais invisible. Personne ne voit rien : l’étudiant continue de sourire, d’aller “à la fac”, tout en se retirant peu à peu du monde.
Lire aussi Trompé d’orientation dans les études : comment rebondir intelligemment ?
Et derrière ce retrait, il y a souvent un conflit intérieur. Entre ce qu’il croit devoir être et ce qu’il voudrait être. Entre les attentes familiales, le modèle de réussite imposé, et ce que son désir murmure à voix basse : “je ne veux plus”.
Certaines familles transmettent des rêves lourds à porter. “Ne gâche pas ta chance.” “Fais honneur à nos sacrifices.” Ces phrases, pleines d’amour, deviennent parfois des chaînes invisibles. Alors l’étudiant décroche — non pour fuir, mais pour respirer.
C’est une forme d’instinct de survie. Une tentative, maladroite mais vitale, de reprendre le contrôle sur sa vie psychique. De dire non à ce qui ne fait plus sens, même au prix du vide.
Car avant de se reconstruire, il faut parfois accepter de tomber.
LIre aussi Trouver sa voie et prendre les bonnes décisions grâce à l’hypnose
Les chiffres du décrochage dans l’enseignement supérieur
- En France, près d’un étudiant sur trois quitte l’université sans diplôme (source : Ministère de l’Enseignement supérieur, 2024).
- 40 % des étudiants déclarent avoir déjà pensé à abandonner leur formation.
- 25 % présentent des symptômes anxieux ou dépressifs modérés à sévères.
- Et selon une étude de Santé publique France, le stress universitaire est désormais la première cause d’abandon des études.
Que révèle le décrochage du point de vue psychologique ?
Derrière le décrochage, il n’y a pas seulement un abandon d’études.
Il y a un abandon de soi, temporaire, douloureux, parfois nécessaire. Une suspension du mouvement, comme si l’esprit disait : “Je ne peux plus avancer tant que je ne sais pas vers quoi.”
Ce moment d’arrêt, souvent jugé, est pourtant profondément signifiant. Il ne parle pas d’un manque de volonté, mais d’une crise du sens. L’étudiant décroche quand la direction prise ne correspond plus à son monde intérieur. Quand la filière choisie, les attentes parentales, la promesse d’un “avenir brillant” cessent de dialoguer avec son désir profond.
Dans le langage de la psychanalyse, on pourrait dire que le sujet se défend contre une aliénation identitaire. Il refuse de continuer à “jouer le jeu” d’un rôle qu’il n’a pas écrit. Ce refus, souvent inconscient, prend la forme d’un repli, d’une anesthésie, d’une fuite dans le silence.
Ce n’est pas une démission, c’est une tentative de réappropriation du désir.
Chez certains, le décrochage traduit un conflit entre le Surmoi familial — cette instance intérieure qui répète les injonctions parentales — et le Moi, qui peine à s’affirmer. “Fais des études sérieuses”, “assure ton avenir”, “ne te loupe pas”. Ces phrases, gravées dans la psyché, finissent par saturer le psychisme. Le jeune adulte se retrouve pris entre la loyauté et la révolte. Et quand il ne parvient plus à concilier les deux, il s’effondre.
Le décrochage, dans ce contexte, devient un acte paradoxalement structurant. Il vient poser une limite là où le sujet ne parvenait plus à dire “non”. C’est un effondrement, oui, mais aussi une naissance possible.
Les étudiants que je reçois parlent souvent d’une sensation de brouillard. Ils ne savent plus qui ils sont. Le corps est fatigué, la pensée tourne en rond. L’humeur se teinte de gris. Derrière ce brouillard, pourtant, quelque chose travaille : une reconstruction identitaire, lente et silencieuse.
On croit qu’ils décrochent du savoir. En réalité, ils décrochent du mensonge.
L’université, lieu de savoir, confronte à la question du désir de savoir : pourquoi j’apprends ? pour qui ? à quelle fin ? Quand ces questions restent sans réponse, la motivation s’éteint. Le décrochage, alors, n’est pas le problème : il est le symptôme d’un désalignement entre le savoir et le sujet.
Et si on écoutait ce symptôme, au lieu de vouloir le réparer trop vite ?
Car parfois, c’est dans l’effondrement que se dit la vérité d’un être.
Lire aussi Comment les fantasmes enfantins façonnent-ils notre identité ?
Comment prévenir le décrochage ?
Prévenir le décrochage, ce n’est pas seulement surveiller les notes ou la présence aux cours.
C’est écouter les signaux faibles — ces petits changements de ton, de posture, de regard. Un étudiant qui s’isole, qui ne rit plus, qui ne dort plus, qui commence à dire “ça ne sert à rien”… L’effondrement commence toujours dans le silence.
Ce silence, il faut savoir le lire.
Derrière l’écran d’un ordinateur, les visages fatigués se confondent, mais chacun porte une histoire : un stress qui monte, une culpabilité de ne pas être à la hauteur, un sentiment d’imposture. Beaucoup de jeunes se sentent piégés dans une spirale invisible où la peur d’échouer devient plus forte que le désir d’apprendre.
Prévenir, c’est d’abord redonner du sens. Parler non pas de réussite, mais de trajectoire. Oser dire qu’on peut se tromper, bifurquer, se chercher. C’est aussi offrir un espace d’écoute — un lieu où l’étudiant peut déposer sa fatigue, sans jugement, sans devoir prouver.
Les universités regorgent d’outils d’aide, mais l’accompagnement psychologique reste souvent sous-utilisé. Beaucoup d’étudiants n’osent pas consulter, par peur d’être “faibles” ou “différents”. Or, l’aide thérapeutique, qu’elle soit psychologique, hypnotique ou coaching, peut précisément éviter le basculement. Elle permet de reconnecter le jeune à ses ressources internes, de raviver la confiance et le plaisir d’apprendre.
Dans certains cas, quelques séances suffisent pour apaiser la tension interne. En hypnose, par exemple, on peut travailler sur la peur du regard des autres, la mémoire bloquée, ou cette fatigue du corps qui dit : “je ne veux plus lutter.” Ces moments de recentrage aident à retrouver un ancrage, une respiration.
Prévenir le décrochage, c’est aussi changer notre regard collectif sur la réussite. Admettre qu’un parcours linéaire n’est pas la seule voie. Qu’une pause, un détour, un arrêt ne signifient pas la fin, mais un réajustement nécessaire.
Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de trébucher. Et quelque chose de profondément thérapeutique dans le droit de recommencer autrement.
Prévenir, c’est reconnaître cela.
Lire aussi Est-ce qu'on naît HPI ou on le devient ?
Comment rebondir après un décrochage ?
Rebondir, c’est d’abord accepter d’être tombé.
Cesser de se juger, de s’excuser, de comparer son pas ralenti à la course des autres. Le décrochage, quand il est traversé avec conscience, peut devenir une formidable porte d’entrée vers soi.
Mais il faut du temps.
Les premiers jours, parfois les premiers mois, sont faits d’un mélange de honte et de soulagement. Honte d’avoir quitté la route que tout le monde semblait suivre. Soulagement de ne plus faire semblant. C’est souvent à cet endroit, fragile et fertile, que le travail thérapeutique commence.
Rebondir, ce n’est pas “retrouver la motivation” à tout prix. C’est recomprendre ce qu’on veut. C’est explorer ce qui, en soi, a cessé d’y croire. Derrière l’abandon des études, il y a souvent un refus du formatage, une soif d’authenticité. Certains découvrent qu’ils ne veulent pas arrêter d’apprendre, mais simplement apprendre autrement.
Quand le jeune adulte peut poser des mots sur ce qui l’a épuisé — la peur de l’échec, la solitude, la perte de sens — alors le travail de reconstruction peut commencer. En séance, il s’agit souvent de rétablir le lien entre le corps et la tête, entre le ressenti et la raison. Car le corps, lui, sait. Il a décroché avant l’esprit.
L’accompagnement thérapeutique aide à retisser ce lien. Parfois par la parole, parfois par des outils plus corporels comme l’hypnose ou la relaxation guidée. L’hypnose permet d’apaiser le système nerveux, de réguler l’anxiété, de rouvrir l’imaginaire — ce lieu où les possibles renaissent.
D’autres trouvent un nouveau souffle grâce au coaching d’orientation. Le coaching n’impose pas de solution : il aide à faire émerger celle qui sommeille déjà en soi. C’est un travail de réappropriation du cap, de revalorisation du talent, d’élaboration d’un plan d’action concret, mais profondément personnel.
Rebondir, c’est aussi se reconnecter au plaisir. Celui d’apprendre, de créer, d’expérimenter, sans l’ombre constante du jugement. Beaucoup d’étudiants “décrocheurs” deviennent ensuite des professionnels passionnés — parce qu’ils ont osé désobéir à une trajectoire qui ne leur appartenait pas.
Et puis, il y a cette phrase que je dis souvent en séance :
« Vous n’avez pas échoué, vous avez résisté à quelque chose qui ne vous convenait plus. »
Rebondir, ce n’est pas repartir comme avant. C’est partir autrement. Avec plus de lucidité, plus de cohérence, plus de douceur envers soi.
Si vous ressentez une perte de sens ou de motivation dans votre parcours universitaire, le coaching scolaire et études supérieures à Versailles vous aide à retrouver confiance, clarté et élan dans vos projets.
Le rôle d’une psychothérapie intégrative dans la reprise d’études
Reprendre ses études après un décrochage, ce n’est pas simplement “revenir à la fac”.
C’est retrouver un lien vivant avec soi-même. La psychothérapie intégrative accompagne cette traversée, en tenant compte de toutes les dimensions de l’être : émotionnelle, corporelle, cognitive, relationnelle et symbolique.
L’étudiant qui décroche ne manque pas d’intelligence. Il manque souvent d’air. Son psychisme sature, son corps se défend, sa pensée se déconnecte de son désir. La thérapie intégrative intervient ici comme un tissage : elle relie ce qui s’est dissocié, elle réunit ce que la pression a fragmenté.
Il n’y a pas une cause unique au décrochage, pas plus qu’il n’y a une méthode miracle. C’est pourquoi l’approche intégrative ne se limite pas à une école de pensée. Elle s’inspire de la psychanalyse quand il s’agit de comprendre les conflits inconscients ou les loyautés familiales, de l’approche systémique pour observer les influences relationnelles, de la TCC ou de la pleine conscience pour apaiser les symptômes anxieux, et parfois de l’hypnose pour réactiver les ressources endormies.
Ce qui compte, c’est le maillage vivant entre ces approches, au service d’une même visée : redonner du mouvement à ce qui s’est figé.
Lorsqu’un jeune vient consulter, il ne cherche pas seulement des solutions. Il cherche un regard qui ne juge pas. Un espace où il peut dire “je n’y arrive plus” sans craindre d’être étiqueté ou corrigé. La thérapie devient alors un lieu de respiration. Un lieu où le silence retrouve un sens.
Dans cet espace, on ne parle pas que des études. On parle du manque, du désir, du corps épuisé, du besoin de plaire. On explore ce que l’université, la famille ou la société ont parfois étouffé : le droit d’être soi, même si ce soi n’entre pas dans les cases.
La psychothérapie intégrative aide à remettre de la cohérence là où tout semblait éclaté. Elle apprend à reconnaître ses émotions, à nommer ses peurs, à transformer la culpabilité en énergie constructive. Petit à petit, l’étudiant retrouve le goût d’apprendre, mais surtout le goût de se sentir vivant.
Certains reprennent leur cursus. D’autres changent de voie. D’autres encore inventent la leur. Le but n’est pas de “raccrocher” coûte que coûte, mais de réinventer le sens du parcours.
Car il n’y a pas de réussite sans alignement intérieur.
Et parfois, c’est la chute qui permet de retrouver la bonne direction.
Lorsque le mal-être semble plus profond, la psychanalyse permet d’explorer les racines inconscientes de vos blocages et d’amorcer un véritable travail de transformation intérieure.
À qui s’adresse cet accompagnement ?
À tous ceux qui, un jour, se sont réveillés avec cette phrase au bord des lèvres : « Je n’y arrive plus. »
Une psychothérapie intégrative s’adresse d’abord à ces étudiants épuisés, pris entre la peur d’échouer et la peur de décevoir. Ceux qui se sentent coincés dans une voie qui ne leur ressemble plus, mais qu’ils n’osent pas quitter. Ceux qui travaillent sans relâche, sans plus rien ressentir, parce qu’ils ont oublié pour qui, pour quoi ils le font.
Elle s’adresse aussi à ceux qui ont tout arrêté. Pas par fainéantise, mais par épuisement émotionnel. À ceux qui ont perdu le goût, la concentration, la confiance. À ceux qui s’en veulent de ne plus avancer, alors qu’ils ont simplement besoin de s’arrêter pour se retrouver.
Il y a aussi ceux qui ont repris, mais qui vivent avec la peur que ça recommence. Ceux qui traînent un sentiment d’imposture, qui craignent de ne pas être “faits pour ça”, qui oscillent entre ambition et auto-sabotage.
L’accompagnement s’adresse enfin à ceux qui cherchent du sens. À ceux qui pressentent qu’ils ne peuvent pas continuer à vivre “en surface”. À ceux qui sentent confusément que leur décrochage n’est pas un accident, mais un message intérieur qu’il est temps d’écouter.
Car parfois, il ne s’agit pas de réparer un parcours, mais d’en comprendre la logique profonde. De donner du sens à l’arrêt pour pouvoir reprendre autrement, plus aligné, plus lucide, plus vivant.
Au Cabinet Psy Coach Versailles, ces accompagnements prennent des formes variées :
parfois de la parole, parfois du silence ;
parfois de l’analyse, parfois de la présence pure.
Mais toujours un espace où l’on peut se dire, se chercher, se retrouver.
Il n’y a pas de profil idéal pour consulter. Il y a simplement une histoire qui demande à être entendue.
Et un pas à faire, non vers l’avant, mais vers soi.
En conclusion : se redresser sans se trahir
Le décrochage n’est pas un échec, c’est un sursaut de lucidité.
Une manière, parfois brutale, de dire : “Je ne peux plus avancer dans cette direction sans me perdre.” Derrière ce mot qu’on redoute, il y a souvent une âme qui cherche à se réajuster à sa vérité intérieure.
Reprendre ses études n’a de sens que si l’on se reprend soi-même. Et c’est précisément ce que permet la psychothérapie intégrative : retrouver un ancrage, redonner du sens à la chute, transformer la peur en connaissance de soi.
Certains étudiants sortent de ce travail plus solides qu’avant, non parce qu’ils n’ont plus peur, mais parce qu’ils ont appris à écouter leurs peurs sans s’y soumettre. D’autres découvrent qu’ils n’avaient pas besoin de “réussir” selon les codes imposés, mais d’exister selon leur propre tempo.
Dans un monde qui valorise la performance, se donner le droit de douter est déjà un acte de courage. Se faire accompagner, c’est refuser la fuite en avant. C’est choisir de comprendre avant de recommencer.
Alors oui, le décrochage fait mal. Mais il peut devenir le début d’un autre récit : celui d’un étudiant qui cesse de s’adapter à tout, pour commencer à s’appartenir.
Et c’est souvent à cet instant précis — quand la course s’arrête — que le véritable apprentissage commence.
FAQ – Comprendre et accompagner le décrochage scolaire dans les études supérieures
Pourquoi ai-je perdu toute motivation à poursuivre mes études ?
La perte de motivation cache souvent un épuisement psychique ou un conflit intérieur entre le choix d’études et le désir profond.
Ce n’est pas une faiblesse, mais un signal de détresse mentale. Un psychothérapeute ou un psychologue peut aider à clarifier ce blocage. Les approches comportementales, psychanalytiques ou humanistes permettent de comprendre l’origine du mal-être et d’engager un processus de guérison psychique, en redonnant sens et cohérence au parcours étudiant.
Comment savoir si je fais un burn-out étudiant ou un simple manque de motivation ?
Le burn-out étudiant s’accompagne souvent de symptômes corporels : fatigue extrême, troubles du sommeil, perte d’appétit, anxiété.
Ce n’est pas un caprice, mais un épuisement mental lié à une surcharge émotionnelle et cognitive. Un praticien en psychothérapie intégrative ou en thérapie comportementale peut aider à identifier les causes de ce traumatisme universitaire et à amorcer la guérison par un travail thérapeutique global, psychique et corporel, pour rétablir la santé mentale et la concentration.
Mon enfant a décroché à l’université, comment réagir sans le culpabiliser ?
Le plus important est d’éviter la pression et la comparaison.
Le décrochage n’est pas un échec, mais un symptôme psychothérapeutique d’un déséquilibre plus profond. L’écoute bienveillante et l’encouragement à consulter un psychothérapeute ou un psychologue sont essentiels. Un accompagnement humaniste ou psychanalytique permettra de comprendre les blocages inconscients et d’aider l’étudiant à guérir du sentiment d’échec. Les psychothérapies comportementales peuvent ensuite soutenir la reprise d’élan et la confiance.
Faut-il consulter un psychiatre quand on décroche des études ?
Consulter un psychiatre est recommandé si le décrochage s’accompagne d’un trouble dépressif ou anxieux sévère.
Il pourra évaluer la nécessité d’un traitement médicamenteux et orienter vers un psychothérapeute pour un suivi psychologique complémentaire. La combinaison des approches psychothérapeutiques et médicales favorise une guérison durable. Dans les autres cas, un thérapeute formé en psychopathologie ou un praticien en psychothérapie intégrative peut suffire à restaurer l’équilibre mental et émotionnel.
Peut-on guérir d’un décrochage universitaire ?
Oui, on peut guérir d’un décrochage.
C’est même souvent un tournant vers une meilleure connaissance de soi. La psychothérapie intégrative associe parole, travail corporel et réflexion analytique pour transformer la chute en tremplin. L’objectif n’est pas de “raccrocher” coûte que coûte, mais de retrouver le plaisir d’apprendre. Les thérapies comportementales, psychanalytiques ou humanistes permettent d’explorer les causes psychiques et de restaurer la confiance en ses capacités.
L’hypnose fait-elle partie d’un accompagnement thérapeutique efficace ?
Oui, dans une approche psychothérapeutique intégrative, l’hypnose peut être un outil précieux.
Elle agit sur les plans neuro-émotionnels et corporels pour apaiser le stress et libérer les blocages inconscients. En complément d’une psychothérapie plus verbale, elle aide à réguler les troubles mentaux liés à la peur de l’échec, à renforcer la motivation et à reconnecter l’étudiant à son potentiel. L’hypnose, bien conduite par un praticien formé, soutient la guérison globale de l’équilibre psycho-affectif.
Comment éviter de retomber dans le décrochage après une reprise d’études ?
La prévention passe par un suivi psychothérapeutique régulier, même après la reprise.
Travailler avec un psychothérapeute sur les schémas comportementaux et les fragilités émotionnelles aide à consolider la stabilité intérieure. Une approche transactionnelle, humaniste ou comportementale permet d’identifier les signaux d’alerte avant l’épuisement. Le but n’est pas d’être parfait, mais de savoir s’écouter. La guérison durable s’appuie sur la connaissance de soi et la capacité à se réajuster.
Le décrochage peut-il cacher un trouble anxieux ou dépressif ?
Oui, souvent.
Le décrochage scolaire peut être la manifestation silencieuse d’un trouble anxieux, d’une dépression masquée ou d’un traumatisme non traité. Ces troubles psychiques relèvent de la psychopathologie et nécessitent un accompagnement adapté. Un psychothérapeute ou un psychiatre peut évaluer la gravité du mal-être et proposer une approche psychothérapeutique intégrant le corps, les émotions et la pensée. Le travail thérapeutique aide à guérir la blessure intérieure et à restaurer une santé mentale durable.
Comment une thérapie analytique peut-elle aider après un échec universitaire ?
L’approche analytique, inspirée de Freud, explore les causes inconscientes du mal-être étudiant.
Le décrochage n’est pas seulement un problème de volonté : il traduit parfois un conflit psychique entre désir personnel et attentes extérieures. En psychothérapie psychanalytique, le praticien aide à mettre en mots ce qui a été refoulé, à comprendre les blocages traumatiques et à redonner du sens à l’expérience vécue. Ce processus de guérison favorise la reprise d’études dans un cadre plus aligné et apaisé.
Le décrochage universitaire peut-il avoir une origine neuropsychologique ?
Oui, certains cas de décrochage sont liés à des particularités neuropsychologiques : troubles de l’attention, hypersensibilité, anxiété de performance, voire troubles du comportement.
Ces réalités, souvent méconnues, relèvent d’une approche thérapeutique intégrative, combinant outils cognitifs, comportementaux et psychocorporels. Le rôle du psychologue ou du psychothérapeute est de détecter ces spécificités et d’accompagner l’étudiant vers des stratégies de réussite mieux adaptées à son fonctionnement mental et émotionnel.
.webp)








